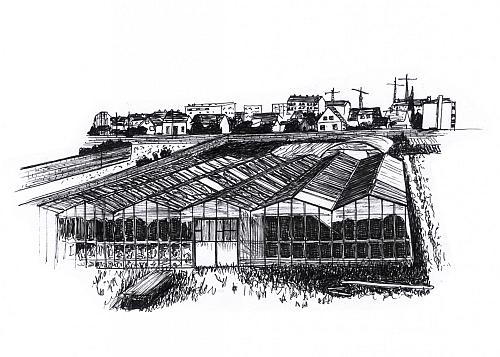Pourquoi avoir écrit de telles histoires ? Pouvez-vous nous raconter la genèse du projet ?
En 2011, nos camarades de Tahin party, une maison d’édition lyonnaise, décident de rééditer « Vers une société écologique » de Murray Bookchin [1]. Dans ce texte, Bookchin décrit un monde organisé par communes fédérées, autonomes pour une partie de leurs besoins essentiels, tout en faisant de la production semi-industrielle, avec des échanges entre les différentes communes. Dans un passage de ce livre, Bookchin s’amuse avec la production d’acier, très énergivore dans son organisation mondialisée actuelle : il projette une production d’acier beaucoup plus locale, qu’il détaille avec des exemples très concrets, documentés. Ce passage nous a inspiré·es, tandis que d’autres aspects du texte nous ont semblé très datés, notamment lorsqu’il imagine des micro-centrales nucléaires.
Notre point de départ a donc été d’écrire des textes supplémentaires, pour faire une édition augmentée de « Vers une société écologique ». Nous avons commencé à nous réunir pour écrire. Mais petit à petit, nous avons glissé vers la fiction, et le projet s’est autonomisé de Bookchin. Il n’y avait à cette époque aucun écrit de science-fiction qui imagine un futur désirable, plus récent que les années 1970. Seulement des dystopies. Nous avons voulu combler ce manque.
Pendant sept ans, à raison de quelques jours par an, nous avons donc écrit Bâtir aussi, collectivement. Tou·tes dans la même pièce, nous écrivions en parallèle chacune et chacun un texte différent. Puis nous lisions nos textes, avant de les faire tourner : chaque personne reprenait ce qu’une autre avait écrit, et ce, plusieurs dizaines de fois.
On imagine souvent la création comme le travail solitaire d’un artiste doté d’un fort ego. Quel intérêt, et quels inconvénients s’il y en a, voyez-vous à l’écriture collective ?
Selon nous, le brillant auteur isolé dans sa tour est un mythe. Le féminisme nous donne à penser que derrière lui, souvent, il y a une femme qui lui fait à manger, avec qui il discute le soir. Nous pensons qu’il n’y a pas d’écriture vraiment individuelle, que tous les gens qui créent discutent de leur création avec d’autres personnes, se nourrissent de ces échanges.
Au-delà de ça, écrire demande de dépasser des peurs, en partie à cause de ce mythe de l’auteur parfait, et en particulier, pour des personnes comme nous qui n’avions pas de trajectoire littéraire. Notre expérience de l’écriture tournait surtout autour des tracts. Pour se confronter à la fiction, il a fallu se sentir légitimes à le faire. Un des intérêts de cette forme d’écriture collective, c’est de se libérer de cette pression. On est plus créatif pour dépasser les blocages à plusieurs.
Par moment, nous avions des visions différentes, par exemple sur des points plus politiques. Une des réponses pouvait être alors de mettre en scène le désaccord à travers les personnages, qui débattent de la question. Car un monde utopique, lisse... c’est louche. Cela nous tenait à cœur d’inventer un univers dans lequel les gens continuent d’avoir des désaccords, de débattre, de réfléchir à la meilleure façon d’organiser le quotidien. De montrer que des intérêts divergents continuent de cohabiter. Et qu’un des enjeux de ce futur désirable, serait de créer de l’égalité, de la liberté, de la justice, de la solidarité malgré ces intérêts divergents.
Notre objectif n’a jamais été de faire de la littérature, mais de faire une action politique : rouvrir les imaginaires. Nous avions alors déjà l’idée des ateliers, que nous avons nommés labofictions. Le livre était un prétexte à faire une tournée, à monter ces ateliers, à encourager d’autres personnes que nous à se réapproprier les imaginaires collectifs et les futurs désirables. Nous ne voulions pas écrire un chef-d’œuvre, mais faire bouger les têtes. Après deux ans et quatre-vingts labo-fictions, nous sommes en mesure de dire que ça fonctionne.
Pouvez-vous nous raconter ces labofictions ? Qui y participe ? Comment se déroulent-ils ? Qu’est-ce qui en ressort ?
Généralement, nous commençons par présenter le livre et la démarche. Pendant une demi-heure, en binôme, chaque personne présente se projette alors dix ans dans le futur, dans le monde de l’Haraka, où le capitalisme a été supprimé. Elle doit se présenter, raconter qui elle est dans ce monde post-révolutionnaire, comment elle occupe ses journées... Nous rajoutons ensuite une consigne, par exemple « racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés dans l’Haraka ». Dans le troisième temps, chaque binôme raconte l’histoire qui a commencé à se tisser à partir des deux récits croisés, et une discussion de groupe s’installe. Sur les ateliers longs, vient alors une quatrième partie, dans laquelle de petits groupes scénarisent des synopsis très courts. Par exemple « un accident industriel vous oblige à quitter votre domicile » ou bien « les panneaux d’information publics commencent à se couvrir de messages dans un alphabet que personne ne connaît. » À partir de ces phrases, il faut ré-ancrer dans les imaginaires : où est-ce que ça se passe, avec qui, comment vous réagissez ? Puis des émissaires partent visiter les autres groupes, écouter leurs histoires, éventuellement se demander des coups de main, s’organiser ensemble.
Il n’y a pas de textes, ni d’enregistrement de ces labofictions. Nous voulions avant tout partager notre méthode : passer du temps dans ce futur désirable, parce que c’est libératoire. Entre camarades de l’Antémonde, nous nous baladons dans la rue et nous nous demandons : « Tiens, dans cette mairie, il y a quoi maintenant, en 2021, une fois qu’on a fait la révolution ? ». Une fois que tu as l’habitude, c’est presque addictif. Tu es tout le temps en train de revisiter ton quotidien.
Il faut cesser de laisser le futur aux gens qui se sentent légitimes à le promouvoir, et plus spécifiquement aux transhumanistes, à la bande à Google. Par exemple, la science-fiction qui est devenue complètement mainstream ne produit que des récits dystopiques. Prenez « Minority Report », de Steven Spielberg (2002) : c’est un catalogue de technologies horribles présentées comme parfaitement normales. Ces gens-là nous imaginent des mondes où seules quelques personnes riches survivront à un monde de plus en plus insupportable et pollué. On est toutes et tous légitimes à imaginer le monde dans lequel on veut habiter, ça n’est pas réservé à une élite.
« Il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme » [2]. Comment est-ce que tu comprends le rôle de l’imagination, et a fortiori de la création artistique, pour la transformation sociale et politique ?
À travers nos labofictions, nous avons découvert à quel point le capitalisme et la technologie sont complètement imbriqués dans les têtes. Lors de l’introduction d’un labofiction, nous expliquons qu’on va se projeter dans l’Haraka, un monde sans capitalisme. Mais la plupart des gens entendent « un monde sans technologie ». C’est-à-dire que tout ce qui n’est pas à leur portée immédiate, tout ce qu’ils ne savent pas fabriquer, ils et elles considèrent n’y avoir plus accès. Cela crée des imaginaires très rudes. Si notre imaginaire d’un monde sans capitalisme est si rude, comment peut-il être désirable, face à tout le confort dans lequel nous sommes noyés à l’heure actuelle ? Confort qui profite à une minorité très privilégiée des humain·es qui habitent ce monde, bien entendu.
Des personnes s’imaginent qu’il n’y aura plus de papier. Pourtant, l’histoire du papier n’est pas liée au capitalisme : on fabriquait du papyrus chez les Égyptiens 5 000 ans avant Jésus-Christ. De la même façon, beaucoup s’imaginent qu’il n’y aura plus de train. Or nous espérons que les cheminot·es ne vont pas simplement lâcher leur travail. Ils et elles auront envie de continuer à faire tourner des trains, surtout débarrassés des patrons. Il y a une fierté du boulot, particulièrement sur les grandes infrastructures comme le train ou les réseaux téléphoniques, qui est en train d’être massacrée. On a pu le voir au procès France Télécom : des travailleurs et travailleuses, qui voulaient bien faire leur boulot, avec fierté, à qui des managers ont dit « tu vas arrêter de planter des poteaux et de relier des gens, tu vas faire de la vente, essayer de refiler le maximum de trucs dont les gens n’ont pas besoin ». C’est horrible.
Nous avons animé des labofictions auprès de travailleur·ses, dans des milieux qui avaient peu l’habitude de penser la question politique. Nous avons alors pu constater que nous venions susciter une sorte de travail syndical. Les gens repensaient leurs conditions de travail dans un monde qui serait autre, et se sentaient libérés.
Nous avons animé des labofictions auprès de travailleur·ses, dans des milieux qui avaient peu l’habitude de penser la question politique. Nous avons alors pu constater que nous venions susciter une sorte de travail syndical. Les gens repensaient leurs conditions de travail dans un monde qui serait autre, et se sentaient libérés.
Pendant les labofictions, au moment où on met ensemble nos récits, on peut refaire société. On découvre que les gens qui nous entourent ont des savoir-faire, et qu’ils ne vont pas disparaître dans un monde post-capitaliste. Des participant·es peuvent très bien décider de rouvrir une usine de papier, ou continuer de faire tourner une imprimerie, ou même réparer des ordinateurs ou des machines à laver. On voit alors qu’un certain nombre d’outils du capitalisme peuvent continuer d’exister, parce que si jamais le monde change nous serons quand même là, tous et toutes.
Votre démarche c’est aussi de « mettre la machine à laver au milieu de la pièce et de voir ce qu’on fait avec ». Il y a un rapport à l’objet qui est important dans toutes vos nouvelles. Pourquoi c’est aussi important les objets ? On ne peut pas s’en passer ?
On ne veut pas s’en passer ! Notre culture féministe est visible, ce choix du lave-linge n’est pas innocent. Qui s’est historiquement occupé du lavoir, et qui va y retourner si on n’a plus de lave-linges ? Nous ne faisons guère confiance aux hommes pour s’emparer des lessives. Ce travail harassant, pénible, est plus facile à se diviser de façon égalitaire si on a des machines pour nous aider. Donc gardons le lave-linge, mais alors imaginons une société qui nous permette de produire des lave-linges, tout en restant désirable.
Parmi nos références, il y a le roman Les dépossédés d’Ursula Le Guin (1974) : sur la planète Urras, il y a eu une énorme insurrection, qui s’est conclue par le départ des insurgés sur la lune, nommée Anarres. Depuis 150 ans, 20 millions de personnes vivent une société anarchiste, avec ses défauts, et ses qualités. Ursula Le Guin en a parlé comme d’une « utopie ambiguë ». Nous nous sommes approprié·es ce concept : nous faisons de « l’utopie merdique », parce que pour vivre il faut parfois mettre les mains dans la merde, soit parce que les toilettes sont bouchées, ou alors parce qu’il faut vider les toilettes sèches.
Est-ce que la question des technologies numériques, des technologies de l’information et de la communication revient souvent dans les labofictions, sous quelles formes ?
Elle revient beaucoup par son absence. Par exemple, très peu de gens se projettent avec un téléphone, qu’il soit mobile ou filaire. Ça nous a étonné que des gens qui ont 40 ou 50 ans se disent qu’on n’aura plus de téléphone filaire. C’est comme si la téléphonie mobile avait complètement éclipsé une technologie beaucoup plus simple, qu’on pratique depuis les années 1920 ou 1930. Les poteaux sont là, les fils de cuivre sont là... En France, on a l’infrastructure, pourquoi est-ce qu’on la démonterait ?
Quant au réseau mobile, il faut voir comment se fait le déploiement en Afrique : par endroits on le passe par les antennes radio, parce que c’était le plus simple à poser, pas de trou à creuser, pas de poteau à planter... Il y a des petits FAI [3] associatifs en France qui parviennent à mettre en réseau 400 ou 500 lieux, comme Tetaneutral à Toulouse. Donc avoir encore le téléphone dix ans après la fin du capitalisme, ça nous paraît possible.
En France, ces dernières décennies, nous sommes passés d’un ordinateur pour 100 personnes à 10 ordinateurs par personne : le casque bluetooth, le téléphone, la tablette, l’ordinateur fixe, l’ordinateur portable, le deuxième téléphone qui traîne dans le tiroir et celui qui est affiché à l’arrêt de tram... En imaginant avoir accès à beaucoup moins d’énergie électrique, nous nous sommes demandés : a-t-on vraiment besoin d’Internet 24 heures sur 24 ? Nous avons alors imaginé un Internet accessible deux heures par jour, créant une autre organisation sociale. Les ordinateurs sont dans des espaces collectifs, ils ne sont plus personnels. Il faut savoir que ça a existé : dans les années 1960, pré-Internet, les universités aux États-Unis partageaient des e-mails et des forums. Les gros ordinateurs de l’époque se passaient des coups de fil la nuit pour synchroniser tout ce qui avait été écrit localement durant la journée. Il n’y a aucune raison que ce système ne puisse pas refonctionner, avec des ondes radio, des communications intermittentes.
En revanche, une vraie question est de savoir comment produire des circuits imprimés et des ordinateurs dans un monde avec une répartition égalitaire de la production. Comment faire pour que plus personne ne bosse dans des usines ni dans des mines qui font de nous des esclaves ? Comment le faire sans polluer à grande échelle ? Nous avons là un désaccord avec des personnes plus technocritiques. À l’Antémonde, nous pensons qu’il est possible de trouver des manières de faire de la petite production, qui reste acceptable.
Bien sûr, il y a des objets qu’on ne pourra plus manufacturer. Mais dans notre histoire, dix ans après la fin du capitalisme, il reste des quantités d’objets technologiques produits avant la révolution. Donc on réutilise et on répare ce qu’on ne sait plus produire. Dans notre monde, il y a énormément de savoirs et de savoir-faire : nous pensons que beaucoup de problèmes ne sont pas résolus actuellement, parce qu’il n’y a pas d’intérêt à les résoudre dans l’organisation économico-politique actuelle. Mais si on était organisé différemment, peut-être que certaines choses inimaginables aujourd’hui existeraient très vite.
Est-ce qu’on aura encore les compétences pour faire fonctionner nos ordinateurs ? Sur le court terme : « Je sais que c’est un ordinateur, mais je suis incapable de le faire marcher ». Trois générations après : « Qu’est-ce que c’est que ce truc-là ? »
Une constante des labofictions, ce sont les archivistes : il y a toujours des gens pour protéger les archives, faire la tournée des collectifs afin de connaître leur fonctionnement, consigner les savoir-faire... C’est peut-être lié à notre public, qui est attiré à partir d’un livre, plutôt intellectuel. Mais à moins qu’ils se fassent tous et toutes tuer pendant la révolution, il y aura des personnes pour perpétuer le savoir et la diffusion des connaissances.
D’autres participants se fantasment « pigeons voyageurs » : ils et elles s’imaginent sur les routes. Dans leur imaginaire, il n’y a plus Youtube, mais on désire toujours partager de la création et des savoirs, ce qui se fait par le voyage.
L’imagination et la fiction, est-ce suffisant ? Comment alors est-ce que cela s’insère dans les luttes et les alternatives ?
Nous ne prétendons pas qu’un labofiction va déclencher la révolution. Nous n’avons surtout pas vocation à être programmatiques. Il faut renverser le capitalisme, et ça demande un mouvement collectif large, c’est sûr. Après, si la perspective révolutionnaire c’est la perspective d’une société très rude où on n’a plus le moindre confort, ça va être dur de se motiver à la faire ! Réenchanter l’imaginaire, c’est un premier pas pour commencer à bouger. Mais ensuite, tous les gens qui ont participé à ce mouvement ne sont pas obligés d’avoir chacune et chacun les mêmes réponses, la même façon d’organiser le monde et la vie.