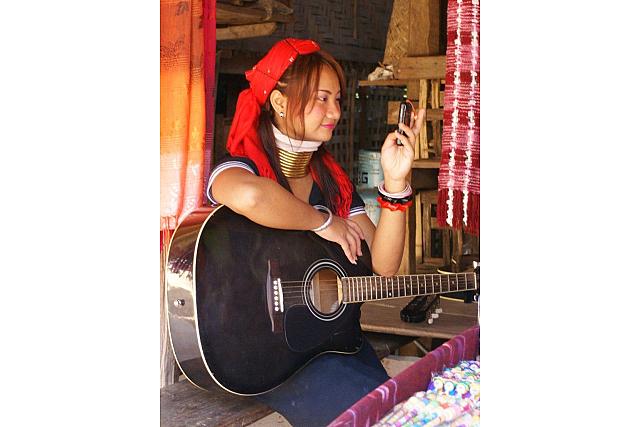Construire une société conviviale et écologique, qui permet le partage du pouvoir, la contribution de tou·tes aux vies de quartier et la création de communs... C’est ce que propose l’association québequoise Solon, du nom du poète et homme d’État grec, avec ses « assemblées de ruelle » qui favorisent les liens sociaux et la logique du pair à pair.

Au Québec, des « assemblées de ruelle » pour encourager le partage
Une initiative sur les biens communs