La loi est fondamentalement limitée dans son potentiel de défi au pouvoir des grandes entreprises et aux dégâts qu’elles provoquent, parce que la loi a été conçue pour faciliter l’accumulation capitaliste et donc les droits de la classe des propriétaires à forcer les autres à se soumettre à leur volonté. On ne peut dès lors s’attendre à aucun potentiel émancipatoire.
Depuis leur naissance, il y a 300 ans, les entreprises ont rencontré de la résistance. Alors que l’entreprise devenait le facteur clé légal pour créer et produire du profit, cette résistance a pris diverses formes. Des esclaves se sont révolté·es, des travailleur·ses ont formé des syndicats, arrêté le travail ou entamé des grèves, des grèves sauvages ont saboté des processus industriels, des réformateurs ont fait passer des législations afin de contrôler les pires formes d’exploitation, des gens ordinaires ont boycotté des produits, des avocat·es défenseur·es des droits humains ont déposé des plaintes contre des compagnies, particulièrement dans les pays occidentaux.
Durant ces 20 dernières années, des actions judiciaires et des législations sont devenues les principaux moyens utilisés pour établir la responsabilité des entreprises. De nombreux efforts ont permis d’intenter des procès dans l’espoir que certains juges reconnaissent la complicité des entreprises dans les violations des droits humains et les dégâts environnementaux, et ordonnent des réparations. Il existe aussi une demande croissante pour un traité pour brider le business et les droits humains (BDH) [1].
De tels espoirs reposent la croyance qu’il est possible de contrôler l’activité des entreprises par des moyens légaux. Le présent essai argumente que la loi ne peut pas être le moyen d’obtenir justice pour les victimes ou de contrôler démocratiquement les grandes entreprises, pour deux raisons principales.
D’abord, parce que le capitalisme peut facilement se remettre des plaintes, les incorporer ou les coopter de telle façon qu’il en sort renforcé et parvient à saper la résistance. Ensuite, et c’est encore plus important, parce que la loi et les systèmes juridiques existent pour faciliter le capitalisme, pas pour le restreindre.
L’action en justice et les réformes législatives sont, par nature, incapables de s’adresser aux paramètres fondamentaux du capitalisme et donc, ne correspondent à rien d’autre qu’à un « réarrangement des chaises longues sur le Titanic ». Pour être efficace dans la lutte contre les dommages causés par les grandes entreprises, il faut aller au-delà de la loi, vers un système structurellement différent.
Dans cet essai, je souligne certaines luttes judiciaires concernant la responsabilité des entreprises et montrerai les limites de l’usage de la loi pour réduire leur pouvoir. Ces limites sont liées à la nature fondamentale du capitalisme de société en tant que système légalement structuré.
Dans ce contexte, les efforts pour faire valoir la responsabilité des entreprises par la loi et la gouvernance jouent, en fin de compte, un rôle idéologique qui permet aux effets du capitalisme d’entreprise de n’être considérés que comme des excès qu’il faudrait limiter plutôt que quelque chose d’inhérent au système. Les grandes entreprises répondent à ceux qui défient leur pouvoir en pratiquant le « faire le bien », « la citoyenneté » et la « durabilité », en se présentant comme faisant partie de la solution ‒ jamais du problème.
De telles actions alimentent l’idée communément répandue qu’il est possible d’un jour voir respectée la responsabilité des entreprises ‒ une promesse puissante, à jamais reportée. Le monde change, cependant, et les fissures dans l’idéologie des entreprises commencent à se révéler au grand jour. Il nous faut redoubler de travail pour créer de nouvelles stratégies de résistance et de subversion au capitalisme d’entreprise au-delà des mises en cause judiciaires, et de commencer à imaginer et construire des alternatives pratiques réelles.
L’idéologie des entreprises et la normalisation de leur pouvoir
Dans l’ombre de l’impérialisme britannique, le modèle anglo-saxon de la « société par actions » (joint stock corporation) ‒ mieux connu aujourd’hui comme « société à responsabilité limitée » (limited liability corporation, LLC ou Ltd.) ‒ est devenu la principale figure légale pour faciliter l’extraction de profit du capitalisme mondial. Ses principales caractéristiques ‒ puisqu’elles ont été adoptées par quasiment toutes les juridictions dans le monde ‒ sont, entre autres, la personnalité légale séparée (pour l’entreprise), une responsabilité limitée (pour les actionnaires suite à des pertes subies par l’entreprise), une durée de vie indéfinie et, dans la plupart des pays, l’obligation légale de donner priorité aux revenus des actionnaires avant toute chose (le « mandat du profit »).

Les entreprises sont conçues pour générer des profits pour un nombre limité de personnes (leurs investisseurs) : leur objectif n’a donc jamais été de bénéficier à la société. Elles accumulent les profits et externalisent les risques : ce sont, intrinsèquement, des « structures d’irresponsabilité ». La structure des grandes entreprises a été utilisée pour orchestrer ou participer à certaines des pires atrocités de l’histoire, parmi lesquelles la Grande Famine du Bengale en 1770, les massacres dans le Congo du Roi Léopold [2], la mise en esclavage d’environ 13 millions d’Africain·es, l’holocauste en Europe, les coups d’État militaires en Amérique latine, au Moyen Orient et ailleurs, ainsi que la destruction de l’environnement à très grande échelle. De plus, les grandes entreprises sont responsables de l’exploitation implacable des travailleur·ses, fournisseurs et locataires et, à l’autre bout du spectre, des consommateur·rices, affectant tous les aspects de nos vies.
Les grandes entreprises gouvernent à présent nos vies à tel point que nous travaillons pour elles, achetons chez elles, sommes soigné·es par elles lorsque nous tombons malades, sommes éduqué·es par elles, emprisonné·es par elles, elles sont même les intermédiaires par lesquelles passent nos relations personnelles les plus intimes, à travers les réseaux sociaux et les applications de rencontre. Avec la « privatisation » rapide de tout ce que nous considérions jusqu’à présent comme des services publics (et des espaces publics), nous en sommes arrivé·es à dépendre de ces entreprises à un niveau sans précédent.
L’idéologie des entreprises vise à occulter la forme légale et le pouvoir des entreprises ‒ c’est-à-dire, à nous faire accepter la grande entreprise comme faisant naturellement et inévitablement partie de notre vie quotidienne et du paysage économique de manière générale. Cette idéologie est une compilation d’histoires produites par les entreprises pour légitimer leur existence, leur forme, leurs opérations et leur croissance. Ces histoires mettent l’accent sur l’importance de ces entreprises pour le commerce et l’emploi, un « service » qui sert l’intérêt général en poursuivant des intérêts privés, et sur la conscience de leur « responsabilité sociale ». Ces histoires servent à justifier la "gouvernance" des entreprises, dans laquelle citoyen·nes et gouvernements acceptent leur pouvoir.
Le principal succès de cette idéologie a été de faire considérer toute violation comme « un excès » de la part de l’entreprise, plutôt que le résultat de quelque chose d’inhérent à leur mode de constitution et au système capitaliste légalement structuré en tant que tel. Cela signifie qu’on nous tient occupé·es à tenter de limiter ou contrôler ces excès, et donc à combattre les symptômes plutôt que la maladie elle-même. Nous essuyons le plancher inondé sans fermer le robinet ! Une énorme quantité de travail est consacrée aux plaidoyers, à la création et au renforcement de tels mécanismes de contrôle. De meilleures serpillières signifient moins d’inondation, et les entreprises ont réussi à nous faire voir les robinets ouverts comme inévitables, normaux et qu’ils se sont pas prêts de disparaître.
On voit les effets de ces contradictions en examinant de près les réformes législatives et les actions en justice, que ce soit sous la forme de mesures de régulation légale de la « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) ou par des poursuites en justice mettant en cause la responsabilité des entreprises. Un tel travail ‒ qui peut avoir des effets positifs significatifs ‒ peut aussi potentiellement exacerber l’oppression raciale et de classe, inhérente au capitalisme.
Ces tendances sont les signes inquiétants qui devraient nous alerter quant aux limites des moyens légaux visant à restreindre le pouvoir des entreprises, et nous amener à considérer les relations profondes, fondamentalement symbiotiques, entre la loi et le capitalisme, et comme l’un facilite l’autre. Loi et capital sont les deux faces de la même pièce et, dans l’ensemble, malgré de petites victoires et quelques effets positifs, la responsabilité légale de l’entreprise est une illusion : les systèmes juridiques ne peuvent que générer des issues favorables au capitalisme [3].
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) et les actions visant à sa régulation légale
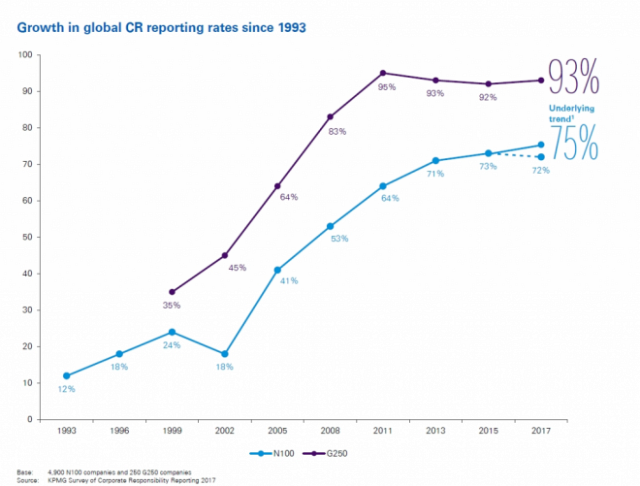
L’industrie de la RSE et les propositions de responsabilité légale sont des expressions de l’idéologie d’entreprise créées réponse à la remise en question de la légitimité du format d’entreprise et des activités à but lucratif.
La RSE ‒ et sa petite sœur « l’entreprise citoyenne » (Corporate Citizenship, CC) ‒ ont, ces dernières années, perdu beaucoup de leur vernis idéologique, et se révèlent fréquemment être des efforts de blanchiment ou de « verdissement ». Bien que les écoles et les cliniques construites par des entreprises dans des régions isolées soient réellement une bonne chose localement (et il y a de vraies raisons pour que des organisations non-gouvernementales (ONG) ou même des ONG de marché [4] soutiennent de tels projets), militant·es et stratèges des entreprises reconnaissent de concert que RSE et CC sont des produits de l’idéologie corporatiste conçus pour que les consommateur·rices (surtout occidentales·aux et, dans une moindre mesure, les investisseurs institutionnels) aient bonne conscience lorsqu’ils et elles achètent leurs produits ou leurs services.
Alors que l’adoption « d’engagements » RSE non-contraignants peut avoir marginalement amélioré le comportement des entreprises, il est également clair que la RSE ne change fondamentalement pas les paramètres en fonction desquels elles opèrent. Par exemple, le « verdissement » de grande échelle réalisé par BP (British Petroleum) n’a pas mis fin à la controverse environnementale ni au modèle économique construit sur la destruction du climat de la Terre. Ceci, parce que la RSE ne change rien, fondamentalement, au fait que les dirigeant·es des entreprises sont obligé·es (par la loi dans la plupart des pays) de servir les intérêts financiers des actionnaires avant toute chose. Les entreprises ne peuvent vraiment « faire le bien » que si cela se traduit par des retours pour les actionnaires.
Un des principaux problèmes que les militant·es progressistes des droits humains et entreprises (Business and Human Rights) voient dans la RSE et les régimes tels que les Principes de conduite des Nations unies (UNGP), développés par le professeur John Ruggie, est qu’ils ne sont pas contraignants, « ils n’ont pas de tranchant ». C’est bien trop facile pour les entreprises de promettre de respecter ces lignes de conduite en principe et ensuite de les « oublier » en pratique.
De plus, si les compagnies « oublient », il n’y a pas de forum approprié (autre que les médias) pour qu’elles rendent des comptes lorsqu’elles ne respectent pas leurs promesses. Ceci ‒ et les accusations « d’impunité des entreprises » suite à plusieurs scandales ces dernières années ‒ a donné lieu à un mouvement de « légalisation de la RSE » et de création de règles légales contraignantes, d’instruments et de mécanismes d’application. Frustrés par ce qu’ils perçoivent comme « un manque de tranchant de la RSE », les militant·es ont principalement travaillé dans deux directions.
La première, prise par les ONG progressistes, les mouvements sociaux et les avocat·es des droits humains, est de pousser à la régulation légale de la RSE en encourageant les États et la communauté internationale à adopter des instruments contraignants établissant des obligations pour les entreprises en ce qui concerne les droits humains et l’environnement. Un exemple de ces mouvements sont les pressions pour une législation sur la transparence des chaînes d’approvisionnement, comme ce que la France et l’État de Californie ont récemment mis en place, ou encore pour des exigences légales de "devoir de vigilance" en matière de droits humains. Au niveau international, les principaux efforts pour réguler légalement la RSE sont menés par un mouvement qui travaille actuellement avec le Conseil des Droits humains des Nations unies sur un « Traité Business et Droits humains » (BDH).
La seconde direction empruntée est celle des juristes spécialisé·es en BDH, qui se sont lancé·es dans des poursuites judiciaires de plus en plus imaginatives, de façon à faire appliquer les principes de droits humains et environnementaux devant les tribunaux. Cela inclut des exemples tels que le cas Urgenda, dans lequel un tribunal néerlandais a condamné le gouvernement des Pays-Bas pour son incapacité à protéger la santé publique de par sa non-action pour ralentir le changement climatique. Cela inclut aussi des plaintes civiles et pénales déposées devant des organismes de réglementation et des institutions judiciaires.
Les plus connues sont les recours collectifs (class actions) contre des entreprises (habituellement en tant que personne légale, parfois en coopération avec des employé·es d’entreprise haut placé·es) qui utilisent le Alien Tort Statute (ATS - Statut de Tort causé à des Tiers étrangers) et d’autres dispositions de la loi états-unienne, qui ont été nombreuses et bien médiatisées. La dernière forme de « RSE armée » implique le dépôt de plaintes contre des entreprises devant la Cour pénale internationale (CPI). Il y a aussi de nombreuses campagnes locales et nationales qui n’ont pas été aussi médiatisée, mais qui intentent des procès et poursuivent des entreprises.
Le côté obscur des luttes pour la responsabilité (légale) des entreprises
Les efforts pour établir la responsabilité sociale des entreprise présentés ci-dessus ‒ RSE volontaire, RSE régulée par la loi et contentieux BDH ‒ ont eu de nombreux effets positifs, dont la prise de conscience publique des activités des entreprises au niveau mondial, ce qui n’est pas négligeable. Un contentieux implique souvent que les tribunaux forcent les entreprises à révéler des détails de leurs opérations qui n’étaient jusque là pas du domaine public. Cette publicité (négative) peut aboutir à ce que des entreprises perdent des contrats ou des clients potentiels et génèrent donc une incitation financière à changer leurs modes opératoires.
Les campagnes pour une responsabilité des entreprises stimulent des débats et des discussions qu’il n’y avait pas auparavant, et éduquent le public en général mais aussi les décideur·ses politiques. De plus, la collaboration entre communautés et juristes progressistes pendant la période de préparation d’un dossier ou d’une campagne, peut être en soi très émancipatrice. Le mouvement pour un Traité contraignant "Business et Droits humains", par exemple, a rassemblé des mouvements sociaux de diverses parties du monde, et généré un partage des connaissances et une information approfondie sur d’autres dossiers bien au-delà de la campagne principale.
Néanmoins, contre-intuitivement et malgré les grands efforts des militant·es, ces stratégies souffrent des mêmes défauts que d’autres stratégies légales, en ce sens qu’elles ne remettent pas en question la structure d’irresponsabilité des entreprises en elle-même, ni le système plus vaste du capitalisme d’entreprise. De plus, ces stratégies jouent le jeu de la dynamique capitaliste qui distribue inégalement la violence selon des lignes raciales, de genre ou de classe, au niveau mondial.
Il ne s’agit pas là simplement d’ "effets secondaires" des méthodes de responsabilité légale, mais révèlent comment celles-ci font intrinsèquement partie du problème. Elles montrent que même lorsque l’on fait le choix du pragmatisme vers un travail de réforme, le capital arrivera à le coopter pour ses propres objectifs ou à saboter toute intention progressiste. Au bout du compte, plutôt que de faire pencher la balance vers une amélioration graduelle, de telles méthodes légales suivront la logique capitaliste et créeront un « marché de la responsabilité » par lequel la responsabilité devient un produit et les dégâts sont remboursés. Le travail des droits humains devient alors une partie intégrante du problème. [5]
Conformité et Classe
Quand les systèmes juridiques mettent l’accent sur les entreprises, ils cherchent surtout à ce qu’elles se conforme aux normes plutôt qu’à appliquer les lois et des sanctions. La conformité met l’accent sur l’incitation aux acteurs à respecter des règles particulières plutôt que de sanctionner les transgressions. Le traitement différentiel ‒ si l’on compare les entreprises avec les individus ordinaires accusés de crime ‒ est le résultat du pouvoir économique du business, des intérêts de classe communs entre grandes entreprises et élites juridiques et politiques.
Lorsque les militant·es expriment leur préoccupation au sujet du « manque de tranchant » de la RSE, il faut noter que la différence entre une norme volontairement respectée et toute nouvelle norme légalement contraignante dans l’approche de conformité, est probablement sémantique. Des règles contraignantes dans un modèle de conformité ont bien un tranchant, mais ces règles ne sont pas appliquées. Les Lignes de conduite de l’OCDE (Organisation de coopération et développement économique) illustrent ce modèle de conformité.
Alors, lorsque l’ONG internationale Global Witness a officiellement porté plainte selon les Lignes de conduite de l’OCDE contre la compagnie minière Afrimex, dont le trafic de minerai avait directement contribué aux violations des droits humains à grande échelle dans la République Démocratique du Congo, cette compagnie a évité d’être sanctionnée après que l’on ait trouvé qu’elle avait violé ces Lignes de conduite en promettant d’adopter un document de politique RSE. [6] De même que les lignes de conduite volontaires, l’approche basée sur la conformité cherche à faire respecter les règles par la persuasion et les incitations financières plutôt que par la menace de l’application stricte des lois. Dans le même temps, la simple existence de règles RSE contraignantes, en combinaison avec une « culture de la conformité », a le pouvoir de dégonfler l’accusation « d’impunité des entreprises ». « Au moins on fait quelque chose », finalement.
Étant donné que les Lignes de conduite des Nations unies suivent un modèle de conformité, il est vraisemblable que l’application des lois nationales incorporant la régulation légale de la RSE suivent la même voie. Le Rapporteur Spécial des Nations unies sur le Business et Droits humains a défini la « responsabilité du respect » des droits humains » comme, « fondamentalement, le fait d’agir avec le devoir de vigilance (due diligence) dans le but d’éviter des atteintes aux droits des autres ». [7] « Le devoir de vigilance » signifie ici de montrer des efforts dans pour se conformer aux normes. Il existe actuellement de grands espoirs que plusieurs pays, et peut-être même l’Union Européenne, adoptent des lois obligatoires concernant le Devoir de vigilance lié aux droits humains (Human Rights Due Diligence laws). [8]
Le problème est que la construction et l’invocation de la culture de la conformité dans laquelle tous les employé·es exercent ce devoir de vigilance a eu deux effets qui sapent une réalisation potentielle de la justice.
Le premier est qu’une entreprise peut se protéger de la responsabilité en adoptant des programmes qui assurent une conformité aux normes en termes techniques sans toutefois réduire l’incidence des « violations ». Si une compagnie est accusée de ne pas exercer « le devoir de vigilance », une soi-disant « défense du devoir de vigilance » peut être invoquée qui permette à l’entreprise d’argumenter que les dirigeant·es avaient bien suivi le protocole.
Le second est qu’il y a un effet de classe, dans le sens où la faute peut être déplacée des directeurs et des gérants vers les travailleurs. En effet, le devoir de vigilance dans les programmes de conformité corporatiste fonctionne à travers la délégation de responsabilité du directeur général par laquelle tous les employés ont une liste de tâches spécifiques, reçoivent une formation en conformité et doivent ratifier l’accomplissement de leurs tâches. En d’autres termes, des conséquences aberrantes sont considérées comme le résultat de la déviation des normes par les travailleu·ses.
Cela signifie que, même dans des pays qui ont instauré une loi pénale des entreprises, la cible la plus probable de l’action de répression (s’il y en a une) est un·e employé·e individuel·le de rang mineur. Ainsi, la responsabilité « légale » immunise l’entreprise elle-même.
Le même processus peut, évidemment, se reproduire au niveau international. Des grandes firmes délèguent la responsabilité de certains problèmes à leurs fournisseurs [9] ‒ une délégation que des campagnes et des législations sur la transparence et la responsabilité dans les chaînes d’approvisionnement s’efforcent de contrecarrer, mais que l’industrie des certifications aggrave [10]. La conformité aux normes, surtout si elle est renforcée par un système d’inspection et de certification, élude la responsabilité des haut·es responsables. Par exemple, elle permet que des entreprises d’exiger de leurs gérant·es de bas-niveau de ne pas surcharger leurs subordonné·es tout en imposant des quotas qui ne peuvent pas être accomplis sans heures supplémentaires obligatoires. Un exemple insoutenable de cela a été révélé dans le contentieux ATS contre les plantations de caoutchouc de Firestone au Libéria. Les quotas quotidiens des cueilleur·ses étaient si élevés que s’ils et elles ne voulaient pas être licencié·es, les travailleur·ses adultes étaient obligé·ses de faire travailler leurs enfants [11].
Dans le même temps, il est très difficile pour des personnes extérieures d’enquêter sur de telles plaintes parce que seul quelqu’un qui connaît de fond en comble ce business particulier pourrait juger du réalisme de ces quotas. Des chercheur·ses de l’Institut de recherches en Économie politique (SPERI) de l’Université de Sheffield au Royaume-Uni, ont découvert que les audits de conformité ‒ y compris ceux sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement ‒ renforcent les problèmes de travail et environnementaux que les ONG luttent pour améliorer. Ils concluent : « Le système des audits, avec l’implication et le soutien d’ONG, réduit le rôle des États dans la régulation du comportement des entreprises et ré-oriente la gouvernance globale vers les intérêts du business privé et loin des biens sociaux ». [12]
Dans le scénario improbable où un tribunal parviendrait à appliquer une norme RSE légale à une entreprise (une nouvelle régulation dans le domaine de la santé ou de la sécurité, par exemple), une peine financière ou la révocation d’une licence pour opérer, cela ne toucherait pas les plus hauts responsables à la tête de l’entreprise. Les coûts de l’application de ces normes seront plutôt compensés en augmentant les coûts des produits et des services aux consommateur·rices, en réduisant le personnel ou en diminuant leur salaire ou leurs conditions de travail, ou bien en taillant dans les dépenses d’autres secteurs, parfois même en supprimant des mesures visant à réduire l’impact environnemental négatif de l’entreprise. Cela signifie que les punitions sont « socialisées » comme tous les autres risques, et peuvent mener à une punition (collective) des travailleur·ses. Dans les années 1970, Ralph Nader avait décrit comment les entreprises pouvaient, et souvent préféraient, choisir de payer l’amende plutôt que d’adopter une technologie en conformité avec les règles concernant la sécurité et l’environnement, si celles-ci se révélaient plus onéreuses. [13]
Plutôt que de contraindre les entreprises capitalistes, les mesures telles que la conformité, qui visent à établir la responsabilité des entreprises, servent à maintenir et reproduire ‒ avec une légitimité renouvelée ‒ le raisonnement d’extraction des profits des entreprises et du capitalisme corporatif, alors que le fardeau de la conformité est disproportionnément porté par les travailleur·ses et l’environnement.
Obligation et impérialisme
La plupart des contentieux Business et Droits humains ont lieu dans des juridictions occidentales ‒ souvent dans le pays d’origine des entreprises ‒ mais visent des violations qui ont lieu dans le Sud global. Ceci pour deux raisons : la première, c’est que les violations de bas niveau dans le pays d’origine restent plutôt invisibles ou apparaissent comme normales ; la seconde c’est que les « avocat·es pour la cause » sont souvent issu·es d’ONG qui reçoivent l’aide au développement des pays du Sud global. Le langage utilisé par nombre de ces juristes révèle la nature impérialiste inhérente de ce type d’activité.
Attaquer des compagnies dans le Nord global pour leurs actions dans le Sud global est décrit par « les expert·es » comme « nécessaire » parce que les pays à faible revenu avec des « systèmes juridiques sous-développés » ne sont tout simplement pas capables de rédiger et d’imposer leur propre législation pour réguler le comportement des entreprises. De plus, dans le Nord global, il est communément considéré que ces pays tendent à avoir « des dirigeants oppressifs », ce qui rend d’autant plus urgent l’établissement (volontaire) de normes de bonne conduite de la part de multinationales dont les sièges sont dans le Nord global. On peut facilement reconnaître cela comme la continuité d’un mode de pensée et de comportement raciste et néocolonial.
Il est bien connu que le déplacement des industries manufacturières et extractives vers le Sud global arrange bien les affaires, parce que cela signifie de moindres coûts et une moindre visibilité des « crimes » pour les consommateur·rices finales·aux. Avec une plus grande vigilance du public cependant, il y a un risque réel que « des scandales » provoquent des dommages à l’image de marque des entreprises. L’idéologie d’entreprise garantit que la faute et la responsabilité dans les scandales soient attribuées à « des sous-traitants mal choisis » plutôt que le résultat de rapports de pouvoir le long de la chaîne d’approvisionnement ou la réduction des prix d’achat. De plus, comme on l’a vu dans le cas du désastre du Rana Plaza au Bengladesh, les principales entreprises peuvent nier toute connaissance de « sous-contrats illégaux » avec des firmes locales.
Ainsi les contentieux BDH peuvent servir à créer une différence entre multinationales « civilisées » basées dans le Nord global d’un côté, et les « compagnies cowboys » des pays hôtes de l’autre. L’incorporation de la RSE dans la loi crée la possibilité (ou la menace) d’imposition sélective envers les entreprises « non-civilisées », pour « niveler le terrain de jeu » [14], et s’assurer que leur mauvaise réputation n’affecte pas toutes les entreprises.
Un exemple de potentiel « contentieux de droits humains impérialiste » pourrait être un cas récent de contentieux contre des géants de la technologie dont Apple, Google et Microsoft, pour la mort ou les blessures graves des enfants qui travaillent dans les mines de cobalt au Congo. L’accusation en recours collectifs concerne le contexte (principalement) africain des conflits liés aux ressources. [15] Ce pourrait devenir l’exemple de l’aspect pro-business de la loi de responsabilité de l’entreprise, si cela suscite des propositions visant à réguler le marché des ressources naturelles dans les régions du continent africain affectées par un conflit, de façon à faciliter des poursuites contre des « traders voyous » et des « mineurs artisanaux » liés à des groupes armés ‒ ce qui permet que les entreprises minent et commercent sans risquer le label de « conflit minier » ou « de permettre le travail des enfants ». [16]

Les « avocat·es des causes » et la reproduction du privilège blanc
L’idéal romantique du mouvement des droits civiques, des « petites gens aux décisions marquantes » [17], de « la loi face au pouvoir », a conduit certains juristes à faire appel à des revendications étatiques traditionnelles, invoquant l’ordre et le contrôle par le biais de la loi pénale. Les poursuites internationales par les lois pénales du début des années 2000, réalisées selon la doctrine de juridiction universelle (qui soutient que certains crimes graves peuvent être jugés dans n’importe quel pays, quel que soit l’endroit où le crime a été commis et où se trouve l’accusé·e), est un excellent exemple ; mais cette tendance déborde sur les actions en justice de type BDH, comme on l’a vu lors des plaintes déposées contre les entreprises devant la CPI, telles que la présentation de l’association Global Legal Action Network (GLAN) contre le réseau australien des centres de détention pour migrant·es situés en haute mer. Ces actions en justice pourraient être perçues comme une forme de résistance ou de lutte de classe, comme un « opportunisme de principe » tactique [18] qui peut réussir s’il coïncide avec « un militantisme judiciaire ». [19]
Ce type d’action en justice qui met en cause la responsabilité des entreprises, cependant, « déplace » le comportement d’entreprise de la juridiction locale (habituellement dans des pays à faible revenu) et du contrôle local potentiel (le site des dommages et les personnes affectées) vers la sphère de la loi internationale contrôlée par l’Occident.
Les avocat·es BDH de ces dossiers créent une relation entre quelqu’un qui devient « la victime » et les entreprises. Le rôle des avocat·es, s’efforçant de persuader les gens à porter les cas devant des juridictions occidentales, correspond en quelque sorte à « répandre la loi capitaliste » (comme mission civilisatrice ou capitalisante) comme ce qu’ont fait les colons d’entreprises au 19e siècle. Pour qu’une plainte soit valide et reconnue, les personnes doivent devenir des sujets de droit, articuler leurs besoins, leurs griefs et leurs désirs en vocabulaire légal devant des tribunaux (en général occidentaux), par l’intermédiaire d’un avocat (habituellement) masculin et blanc. Ils doivent « rejoindre le système » de la même façon que les peuples « décolonisés » ont dû rejoindre le système occidental des États et la loi internationale européenne.
En tant qu’avocat·e BDH, je pourrais croire que je suis le/la facilitateur·rice, le facteur d’émancipation dans cette équation, mais en pratique je produis (je constitue) les « victimes » [20] et demande à ce qu’elles se fient à mon expertise. Je deviens ainsi un entrepreneur des droits humains, revendiquant parler pour les opprimé·es et pour la justice, mais en réalité je parle en tant que celui qui applique le capitalisme. Ainsi, sans le vouloir, les avocat·es BDH créent de la valeur pour les entreprises et le capitalisme d’entreprise ‒ extraite de celles et ceux sur qui les souffrances ont été infligées ainsi que (souvent) de l’environnement ‒ avec des « victimes » à peine « dédommagées », ou pas du tout. Nous pourrions souhaiter voir une multinationale traînée en justice mais cela n’arrivera pas, même pas « un jour », car le système capitaliste et judiciaire ne l’autorisera pas.
Loi et capital : créer un « marché de la responsabilité »
Grâce aux avocat·s des causes face à la responsabilité des entreprises occidentales, les individus affectés (habituellement dans le Sud global) sont étiquetés comme victimes de la relation judiciaire par laquelle ils sont traités formellement comme des égaux aux entreprises ‒ une relation qui gomme les inégalités de pouvoir évidentes entre les parties. Ici, les victimes doivent négocier « le prix » des dommages qui leur sont faits [21]. Le décideur d’entreprise en arrive à calculer le bénéfice de la violation (p.ex. les conflits liés aux diamants risquent d’être plus chers que de financer des diamants « propres ») par rapport à une issue probable de toute procédure juridique, pour déterminer si arriver ou non à un accord.
Il y a beaucoup de facteurs en jeu pour former cette décision ‒ la possibilité que les personnes affectées parlent à ou trouvent (ou sont trouvées par) une organisation de défense des droits humains ou un·e expert·e des Nations unies, la possibilité qu’elles lancent un contentieux, qu’un tribunal de justice fasse durer une procédure pendant quelques années pendant que des ONG médiatisent le contentieux, l’estimation du coût d’une chute des ventes ou de la valeur des actions, ainsi que le prix des honoraires. La décision de provoquer ou non des dommages a un prix calculable. Pour la « victime », le besoin et le désir de ne pas souffrir de blessures devient « un droit » qui peut mériter d’investir, par exemple, dans des honoraires d’avocat·es ou de temps éloigné du travail productif, pour obtenir une chance calculable de succès. Quel est mon prix, pour quelle somme suis-je prêt·e à abandonner toute plainte future ?
Il vaut la peine de se demander pourquoi des entreprises (telles que Shell face au contentieux Ogoni devant les tribunaux états-uniens) accepteraient un accord si l’on sait que la possibilité d’une victoire des plaignant·es est proche de zéro. La raison est que même si elles paient, de tels accords bénéficient aux entreprises qui paraissent ainsi généreuses et se rétablissent d’une période de mauvaise presse, tout en obtenant des plaignant·es qu’ils et elles signent des déclarations de renoncement à toute future revendication. Plus important, selon Michael Sfard, avocat de droits humains, dans un contexte comparable, cela fournit « un ballon d’oxygène » au système lui-même et l’aide à le rendre durable et légitime. [22]
Ces cas de responsabilité des entreprises, donc, font passer le « crime » d’un problème qui concerne la société internationale à un problème entre une victime individuelle (ou un groupe) et une entité économique puissante dans un État puissant. Ce qui en fait un problème quantifiable s’il est « réglé » ou si l’entreprise reçoit une sanction financière. [23] En décembre 2011, Trafigura par exemple, a été ondamnée par un tribunal néerlandais pour avoir dissimulé la nature dangereuse des déchets à bord du navire Probo Koala. L’amende de l’entreprise a été réduite par le tribunal à un million d’euros parce qu’elle avait mis sur pied un fonds de compensation pour les victimes. [24] Cette « solution » sert à retirer la « victime » du tableau en tant qu’agent et la place simplement en position de récipiendaire des gestes de bonne volonté de la part de l’entreprise. [25]

D’autres cas, présentés en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, qui cherchaient une compensation pour les torts causés à des milliers de citoyen·nes de Côte d’Ivoire suite aux déchets rejetés par le navire de Trafigura, ont abouti à des non-lieux et à des accords hors des cours. [26] Les individus affectés sont forcés de vendre leur droit à rester libre de tout dommage. Je dis « forcés » parce que la situation est comparable à celle de travail « libre » ‒ qui peut être nécessaire pour la survie, tout comme n’importe quel·le travailleur·se dans un boulot mal payé ne peut quitter une situation dans laquelle ses droits sont violés. Ainsi, le paradigme « droits contre crime » est essentiellement néo-libéral : c’est à chaque individu de « valoriser » sa propre responsabilité ou de revendiquer (négocier, échanger) son droit : revendiquez votre prix ! La responsabilité pour avoir violé un droit (qui a provoqué des torts) existe seulement parce que ce droit (ou la valeur qui lui est attachée) est revendiqué.
Le résultat de la RSE incorporée dans la loi soutient donc l’idéologie de l’entreprise de « moralité en conserve » ‒ la diffusion de la désapprobation morale tournée en produit de façon à cacher la structure de l’entreprise et ses effets plus larges sur la société et l’environnement naturel. La transaction la plus importante achète les victimes existantes ou potentielles et les placent dans un rapport d’échanges qui revient, en un retour, à un compte équilibré, et à l’innocence. De cette façon, la responsabilité est socialisée et l’entreprise légitimée.
Les exemples ci-dessus montrent qu’alors que nous cherchons à améliorer les instruments ou les arguments juridiques, la raison sous-jacente de l’échec de nos efforts à réduire les dommages causés par les entreprises n’est pas le manque de lois, mais bien la loi elle-même. Le capitalisme est « bâti » sur des lois et la loi est à l’origine de l’accumulation capitaliste ‒ surtout, les normes de la propriété privée, qui permettent les échanges dans le marché ‒ ; elle est violente et hiérarchique par nature car elle inclut le droit d’exclure d’autres de « ma » propriété. Le droit des contrats, le droit pénal, le droit du commerce et le droit des sociétés existent pour protéger les droits de la propriété privée et de l’accumulation capitaliste ‒ et donc les droits de la classe des propriétaires à forcer d’autres à se soumettre à leur volonté. On ne peut donc en attendre aucun potentiel émancipatoire.
Construire un contre-pouvoir et des alternatives
Le grand danger de se fixer sur des mécanismes de responsabilité légale est qu’ils absorbent à la fois une critique du capitalisme et une résistance populaire anti-capitaliste. Ils les placent dans une lutte dans laquelle la violence inhérente au capitalisme est réduite à une « erreur d’entreprise » et une illusion par laquelle, une fois que des mécanismes pour rendre des comptes sont mis en place, on a trouvé la "solution" à l’entreprise et donc le capitalisme.
Il faut rediriger cette énergie, ces savoir-faire et ces engagements pour un monde meilleur, vers des stratégies de résistance au pouvoir des entreprises qui transcendent le réformisme. Nous pouvons voir le pouvoir pré-figuratif des coopératives comme des alternatives aux entreprises à but lucratif, aux tactiques des grèves, des sabotages et plus généralement des luttes des travailleur·ses dans une économie changeante. Nous pouvons apprendre de mouvements tels que Jackson Cooperation au Mississipi ‒ et groupes similaires partout dans le monde ‒ qui cherchent à transformer leur économie productive à partir du sol ‒ pour des suggestions sur comment travailler (ou pas) pour un autre monde au-delà du capitalisme corporatiste. Pour transcender ce capitalisme, nous devons booster le contre-pouvoir collectif et, en masse, construire des modèles de production viables de longue durée qui puissent satisfaire nos besoins quotidiens et ne dépendent pas de la minorité qui en tirent des profits.
On pourrait se demander pourquoi nous ne pouvons pas faire les deux : continuer le travail réformiste tout en cherchant des alternatives. La première raison est que, comme montré ci-dessus, les efforts pour arriver à responsabiliser les entreprises fournissent de l’oxygène au capitalisme, lui donnent une légitimité de surface, et l’illusion d’être inévitable et largement sous contrôle. Ces efforts finissent souvent en une cooptation ou une subversion et deviennent au mieux inefficaces, et, au pire, contre-productives. Mais surtout, ils soutiennent un système qui porte atteinte aux gens du Sud global, les plus pauvres, les premières victimes du racisme et de la discrimination de genre ; et qui, actuellement, menace la survie de la race humaine et de toutes les espèces.
Le monde est dans un état de fluctuation, et la conscience de la nature et de la forme du pouvoir des entreprises, des souffrances qu’il cause aux les travailleur·ses et à l’environnement, n’a jamais été aussi importante. La plupart des gens s’accordent aujourd’hui sur le fait qu’il est impossible que les États puissent réguler le pouvoir des entreprises, et nombreux sont ceux qui pensent que le changement n’intéresse tout simplement pas les États et élites. Dans le même temps, les travailleur·ses et les militant·es pour une justice sociale réalisent que les vieilles méthodes de plaidoyers et de campagnes ne sont plus suffisantes. On ne peut détruire la maison du maître en utilisant ses outils, même si l’on espère le contraire. De nouvelles formes de résistance émergent et d’anciennes formes de lutte contre le capitalisme font leur retour. Nous allons avoir besoin de toute l’imagination, la créativité et le courage que nous pourrons rassembler pour lutter pour un monde qui puisse survivre au-delà de demain.
TNI promeut le débat et la discussion parmi les mouvements progressistes sur des sujets essentiels et est heureux d’inclure cet essai sur l’importante question concernant les mécanismes qui pourraient mieux contrôler, transformer ou remplacer la grande entreprise. Dans L’État du Pouvoir 2020, on trouvera aussi des essais écrits par Adoración Guamán et Brid Brennan avec Gonzalo Berrón, qui défendent l’idée d’utiliser les lois internationales pour les droits humains, comme élément d’une stratégie plus globale de mobilisation, de luttes contre l’impunité des entreprises et pour un accès à la justice pour les communautés affectées. Faites-nous savoir ce que vous en pensez !
