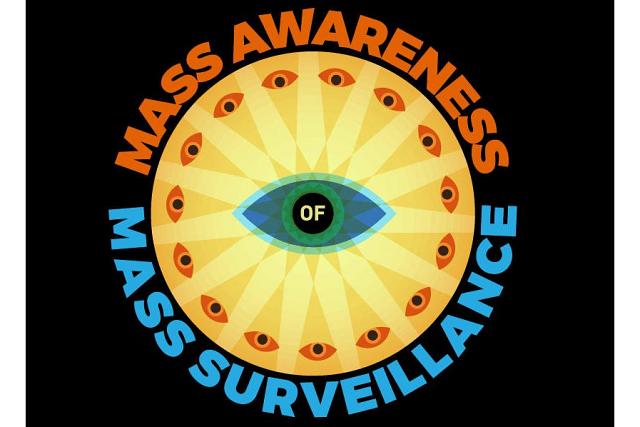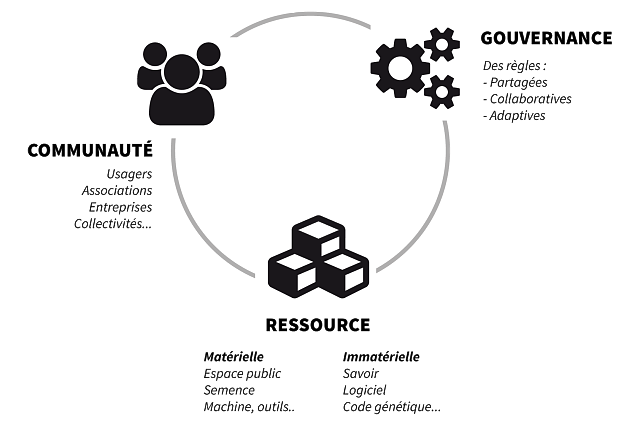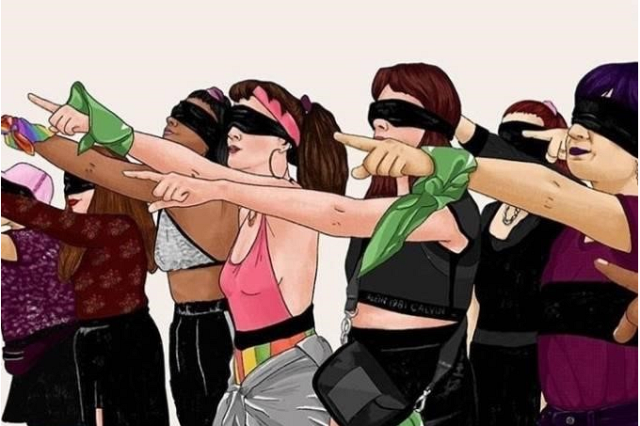Vous pouvez (re)voir le webinaire "Low tech : se réapproprier le numérique", qui s’est déroulé le mercredi 24 juin 2020 à 18h30 sur le logiciel BigBlueButton hébergé par Octopuce, et était organisé par ritimo et le comité éditorial du numéro 21 de la collection Passerelle.

(Re)voir le webinaire "Low tech : se réapproprier le numérique"
Podcast