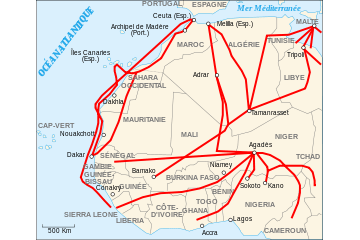La Bosnie-Herzégovine peine encore à surmonter les profondes blessures et les traumatismes causés par la guerre civile sanglante des années 1990. Dans un pays de minorités, la constitution rédigée il y a près d’un quart de siècle par des experts occidentaux définit vaguement les ethnies les plus minoritaires comme « les autres ».