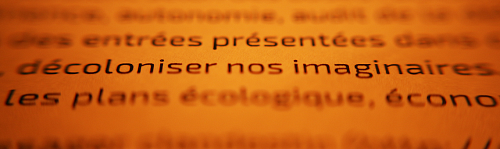
Éclairons d’abord les différences entre l’anticolonialisme des années 1950-1960, les études postcoloniales anglophones des années 1980 et les études décoloniales hispanophones des années 1990-2000. L’anticolonialisme se développe pendant les luttes des pays africains et asiatiques pour leurs indépendances, surtout vis-à-vis des métropoles françaises et anglaises. Aimé Césaire et Franz Fanon, qui écrivent en français, sont les grandes références de l’anticolonialisme : ils déconstruisent le regard condescendant que les colonisateur·rices portent sur les sociétés qu’ils et elles ont colonisées tout comme l’intériorisation d’une supériorité métropolitaine par les élites locales.
Les études postcoloniales ont quant à elles deux épicentres, tous deux issus du Commonwealth : les départements de lettres australiens autour de l’ouvrage emblématique The Empire writes back de Bill Ashcroft et un groupe d’historien·nes d’Inde qui coordonnent les Subaltern Studies. Critiques des grands récits de la modernité, de l’orientalisme mais aussi des nationalismes réducteurs et essentialisants dans leurs propres pays indépendants, ils et elles revendiquent et assument leur hybridité comme celle de leurs mondes. Pour la plupart issu·es des castes supérieures de leurs pays, ils étudient dans les meilleures universités d’Angleterre et écrivent en anglais. Ils et elles acquièrent progressivement reconnaissance et légitimité dans les centres mondiaux du savoir (États-Unis et Angleterre pour l’essentiel), célèbrent la poétique du fragment dans un monde globalisé, dissèquent la complexité de leurs cultures inextricablement liées et marquées par leur passé colonial et dissertent depuis la philosophie sur la possibilité même que les subalternes parlent.
Les études décoloniales quant à elles émergent des sciences sociales latino-américaines, un espace marqué par une histoire coloniale différente (ibérique), plus ancienne (XVIe siècle) et surtout une indépendance plus précoce (XIXe siècle), parfois antérieure à l’indépendance de certains pays européens comme la Grèce ou l’Italie. Le contexte historique et linguistique d’émergence diffère donc radicalement des auteur·rices anticoloniaux·les – principalement francophones – et des études postcoloniales anglophones. De plus, les études décoloniales émergent depuis les sciences sociales, en particulier en sociologie, en anthropologie et en économie. Elles sont nourries par toute une tradition marxiste et matérialiste latino-américaine qui épouse le rythme des groupes révolutionnaires et des mouvements sociaux urbains d’Amérique latine, et qui tranche avec les approches principalement littéraires et historiques des études postcoloniales. Enfin leurs idées et leurs orientations politiques diffèrent : selon la perspective décoloniale, le racisme est indissociable du capitalisme mondial qui naît en 1492 avec la conquête de l’Amérique. Et l’indépendance politique du XIXe siècle n’a pas mis fin à la domination économique et symbolique qu’exercent les ex-métropoles : la colonialité du pouvoir, du savoir et de l’être continue de se reproduire chaque jour dans les structures matérielles et idéelles du système monde.
Il existe cependant un point de jonction entre les études postcoloniales et décoloniales : les auteur·rices latino-américain·es qui feront connaître ces études décoloniales circulent, étudient et publient dans les universités nord-américaines. C’est d’ailleurs ce qui permet au groupe de prendre conscience de ses différences avec les postcoloniaux·les. Notons toutefois qu’ils et elles tiennent tou·tes à publier en espagnol et portent un intérêt marqué aux langues et sociétés autochtones, au point parfois d’en avoir une vision romantique, déconnectée de la réalité. Ils et elles renouent avec les grands récits émancipateurs auxquels les postcoloniaux·les avaient renoncé, et de manière significative, relisent et intègrent des anticoloniaux·les comme Franz Fanon parmi leurs auteurs de référence.
Que disent les décoloniaux·les que ne disaient pas déjà les anticoloniaux·les et les postcoloniaux·les ? Anibal Quijano, qui a forgé le terme « colonialité », ne pense plus « la colonisation de l’imaginaire des dominés » [1] comme étant seulement un héritage de la colonisation que subissent encore les ex-colonisé·es dans le cadre actuel d’États-Nations formellement indépendants. Ce n’est plus non plus un facteur explicatif du sous-développement de la région latino-américaine. La « colonialité » devient chez Quijano un phénomène socio-historique mondial de longue durée, à expliquer, et coextensif de la modernité. Pour lui, « la simultanéité entre la colonialité et l’élaboration de la rationalité-modernité ne fut en aucun cas accidentelle ». [2] Pour que Descartes puisse écrire « je pense donc je suis » et se poser comme un sujet pensant en soi et pour soi, qui produit une connaissance sur un objet extérieur à lui-même et qui possède des qualités intrinsèques, il faut commencer par nier que la connaissance est intersubjective et relationnelle. Pour considérer que son point de vue est rationnel et universel, il faut faire partie des maîtres de la structure mondiale du pouvoir, position que l’Europe de Descartes acquiert par la conquête des Amériques. Dans les relations intersubjectives, seul le sujet occidental est alors rationnel tandis que les autres ne peuvent être qu’irrationnels et « objets de connaissance », appropriables. Pour penser autrement, il faut se libérer de « la prison de la colonialité ». [3]
Dans l’article qu’il écrit la même année avec Immanuel Wallterstein, Anibal Quijano développe une deuxième idée socle, à savoir que le racisme n’est pas seulement une idéologie justificatrice a posteriori du système monde, mais qu’il est consubstantiel au fonctionnement du capitalisme : le capitalisme, tel qu’il prend forme avec la conquête des Amériques, instaure une division raciale du travail au niveau mondial. Plus tard, en 2000, Anibal Quijano articule ensemble trois formes de colonialité - la colonialité du pouvoir, du savoir et de l’être - et détaille la logique du système mondial de pouvoir, en tant que système qui organise les existences, fondé sur la classification sociale de la population mondiale (racisme), le contrôle des ressources et des produits du travail (entreprise capitaliste), de la sexualité (famille bourgeoise), de l’autorité (État-Nation), de l’intersubjectivité (eurocentrisme). [4] Autrement dit la colonialité du pouvoir est avant tout une perspective pour comprendre non seulement l’Amérique latine mais le système monde dans son ensemble.
En 2008, Maria Lugones élargit de manière significative la proposition d’Anibal Quijano en proposant le concept de « colonialité du genre » dans un article publié à la fois en espagnol [5] et en anglais. [6] Elle pointe tout d’abord une limite dans la pensée de Quijano qui « paraît tenir pour acquis que les conflits sur le contrôle du sexe sont des conflits entre hommes, autour du contrôle exercé par les hommes sur les ressources, qui sont supposées être des femmes ». Cette vision, qui réduit les femmes à l’état d’objet-ressource et leur nie toute capacité à penser et agir, provient précisément de la « construction genrée de la connaissance » [7] moderne/coloniale. Maria Lugones s’appuie alors sur des travaux qui ont cherché à montrer que les sociétés précoloniales d’Afrique et d’Amérique témoignaient soit d’une absence de genre, soit de gynocraties, soit d’une reconnaissance de l’homosexualité féminine et masculine. Le patriarcat ne serait apparu qu’avec la colonialité/modernité. Ce dernier point est à son tour contesté par Rita Laura Segato qui propose plutôt de distinguer le patriarcat de basse intensité des sociétés précoloniales et le patriarcat de haute intensité des sociétés modernes/coloniales. [8]
Un autre point de débat porte sur la manière de penser le métissage et le devenir des communautés amérindiennes et afro-américaines d’Amérique latine : si le monde entier est en permanence travaillé par la colonialité du pouvoir, il n’existe pas d’extériorité pure et radicalement autre à partir de laquelle la critiquer ou la renverser, seulement des résidus et des failles toujours provisoires, des critiques toujours partielles et fragiles. La possibilité même de pouvoir sortir de la « prison de la colonialité » est en jeu dans ces réflexions.
Dernière ligne de débat interne, chacun·e des auteur·rices qui se revendique encore aujourd’hui comme étant décolonial·e articule à des degrés différents sa vie académique et sa vie militante et nombreux·ses sont celles et ceux qui critiquent l’« académisation des pensées critiques », voire leur marchandisation et chosification afin de préserver une pensée toujours en mouvement et en prise avec les inquiétudes des hommes et des femmes qui les entourent.
La notice suivante s’appuie sur la coordination d’un dossier pour les Cahiers des Amériques latines aujourd’hui identifié comme l’une des premières introductions de ce courant en France (2010), sur un colloque organisé en collaboration avec Ramon Grosfoguel en 2011 et publié dans les années suivantes, [9] sur le travail de traduction et introduction de Claude Rougier Bourguignon depuis 2014 [10] et sur les critiques et traductions des collègues françaises qui font connaître les féminismes décoloniaux en France : les Cahiers du cedref [11] depuis 2011, le chapitre de synthèse de Jules Falquet, [12] une anthologie et des traductions récentes de Rita Laura Segato. L’objectif est de donner quelques éléments pour comprendre l’histoire sociale des idées et du réseau de chercheurs et chercheuses pour la plupart latino-américain·es et caribéen·nes qui s’en revendiquent à un public francophone. Il n’est pas exhaustif et son histoire continuera de s’écrire dans les années qui viennent.
