Après la publication en 2017 d’un guide pratique « répondre aux préjugés sur les migrations », ritimo a souhaité aller plus loin en proposant une formation « animer en ECSI autour des migrations » afin d’interroger les outils et méthodes pédagogiques qui décryptent la réalité des migrations.
De son côté, La Cimade, après avoir développé les permanences de soutien juridique aux personnes en migration, s’est lancée, il y a une décennie, dans « la sensibilisation aux migrations ». En 2020, l’association a publié plusieurs outils portant sur les droits des enfants migrants.
Échanges avec Elsa, qui coordonne les actions de sensibilisation au niveau national à La Cimade, sur le rôle et les outils de l’éducation populaire dans la déconstruction des préjugés sur les migrations.
La Cimade vient de publier trois nouveaux outils pédagogiques, un guide et une exposition, axés sur les droits des enfants, et également un court film d’animation visible en fin d’entretien. Pourquoi vous avez pensé qu’il était important de s’intéresser aux droits des enfants ?
Le guide « protéger les enfants et leurs droits » a été réalisé en 1er,l’exposition est arrivée par la suite. Ce petit guide veut donner à voir la situation des enfants en migration.
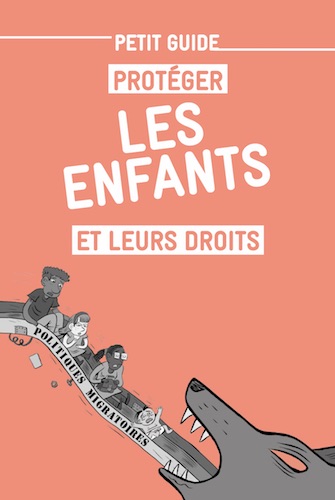
On a choisi d’aborder la question par les situations concrètes des enfants : par exemple, leur enfermement en centre de rétention, ou la non prise en charge des « mineur·es isolé·es », c’est à dire celles et ceux qui partent en migration tout·es seul·es.
On y aborde aussi les différents droits de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) : quels droits sont respectés ou non par l’État français ?
Notre idée, avec ses outils, c’est d’informer, de sensibiliser et de dénoncer des situations absurdes. Ce sont des outils qui s’adressent donc plutôt au « grand public », aux adultes. Lorsque nous y avons réfléchi initialement pour le festival Migrantscène (on y présente toujours une exposition), on s’était dit que c’était bien de repartir de ce petit guide et que l’exposition soit accessible, appropriable par les plus jeunes et qu’elle puisse être utilisée dans les collèges/lycées.
Ce qui est nouveau avec les expositions, c’est qu’il y a un dernier panneau sur des expériences positives, qui se terminent bien. C’est la différence avec le guide.
On y a aussi ajouté des explications de vocabulaire pour les plus jeunes.
Ce besoin « d’expériences positives » nous est apparu avec les retours des bénévoles à la sortie du guide. Au-delà de la glorification de parcours individuels, on voulait donner envie d’agir. Si on rééditait le petit guide aujourd’hui, on intégrerait cette ouverture.
Quand on fait de l’ECSI, on se pose souvent la question du besoin de montrer des alternatives. Est-ce que la dénonciation d’inégalités, du non-respect des droits… ne peut pas suffire pour le passage à l’action ?
Quand on dit qu’on a choisi de mettre en lumière des parcours « exemplaires », cela ne veut pas dire que si la personne en migration avait été moins bonne dans son parcours, elle ne serait pas aussi légitime à obtenir des papiers. A La Cimade, au-delà de notre plaidoyer, on parle assez peu de ce qui marche. De temps en temps, c’est bien de mobiliser ces profils et des expériences collectives. Sur le sujet des migrations et des enfants, quand les gens ont compris la/les situation(s), il y a un côté « les bras m’en tombent », « qu’est-ce que je peux faire ? ». Si on reste sur le négatif, il peut y avoir un côté un peu désespérant.
Comment avez-vous sélectionné ces expériences collectives ?
Pour construire le petit guide, on a travaillé avec trois bénévoles.
Un d’eux est enseignant et a soumis le texte à ses élèves pour qu’on puisse voir si c’était adapté, si c’était accessible.
Parmi les témoignages, on a celui d’une éducatrice en CPH (« centre provisoire d’hébergement », une structure qui accueille des personnes avec le statut de réfugié·es, mais qui connaissent pourtant encore des problèmes d’accès aux droits). On peut y croiser des parents venu·es seul·es, dont les enfants sont encore au pays d’origine. De nombreux travailleur·ses sociaux·ales travaillent sur cette question. C’est un tel déchirement pour les familles séparées, que le jour où la question du rapprochement familial est réglée, ça débloque pas mal de choses. C’est un seuil à passer.
On a aussi le témoignage de deux lycéens. Dans leur lycée, il y avait un jeune afghan embauché au service technique. Les enseignant·es ont appris son histoire un peu par hasard, ils·elles lui ont demandé s’il voulait bien témoigner de son parcours. Les jeunes lycéen·nes ont tellement été marqué·es qu’ils·elles ont décidé de faire un atelier d’écriture, pour raconter son histoire. Un livre est sorti, il a été primé. Il y a eu aussi un film sur leur expérience (« On a beau tuer les hirondelles », d’Anne Jochum). C’est un très beau documentaire, positif… Ça donne une autre image de la jeunesse, qui va contre les discours habituels sur le manque d’engagement des jeunes.
Comment est-ce que vous défendez cette idée qu’il n’y a pas besoin d’être exceptionnel·le pour obtenir des papiers, alors que l’actualité semble montrer que c’est plutôt la posture du gouvernement ?
On redit que La Cimade se bat pour des papiers pour tou·tes. Il n’y a pas des bon·nes migrant·es d’un côté et des mauvais·es migrant·es de l’autre. C’est le combat qu’on mène avec nos permanences juridiques, dans lesquelles on reçoit des personnes étrangères, qu’on aide à faire leurs démarches administratives. Ça nous permet d’avoir une vision sur tout le territoire métropolitain et ultra-marin : on voit les pratiques des préfectures et ça nous permet de les montrer du doigt. Il existe un vrai enjeu pour les années à venir : la dématérialisation (qui ne concernera pas que les étranger·es) et qui empêchera d’avoir accès physiquement aux guichets des préfectures.
Comment arrivez-vous à faire ressortir cette complexité dans vos animations, ou avec vos guides et expositions pédagogiques ?
Cela dépend surtout du public : collégien·nes, public de médiathèque ou militant·es…
Autour de chaque outil de sensibilisation, on prévoit des petites fiches d’animation. On va organiser des débats. Ce qui va beaucoup intéresser les jeunes, c’est souvent le droit à la scolarité. Pour sensibiliser, il faut réussir à faire le lien entre ce qui touche le public et notre sujet. La scolarité, ça parle aux jeunes.
Est-ce que cela veut dire que, peut-être, dans le contexte actuel, vous avez pu noter une sensibilité particulière sur le droit à la santé ?
L’exposition n’est pas née il y a suffisamment longtemps pour que les établissements scolaires s’en saisissent. Mais effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l’accès au droit à la santé des personnes en migration.
Quand on anime dans un contexte pédagogique autour des migrations, on se pose beaucoup de questions de terminologie. Vous avez mentionné l’expression de « sensibilisation aux migrations » ?
La Cimade utilise ce terme depuis 10 ans. Pendant longtemps, elle n’a pas eu de réflexion sur la pédagogie, et est donc restée loin des « éducations à ». Pendant longtemps également, nos activités de sensibilisation reposaient essentiellement sur le festival migrantscène, et donc sur des activités culturelles : du théâtre, des films… La Cimade organisait alors peu d’activités de jeu, d’animation… C’est devenu de moins en moins vrai. Il y a eu une grosse envolée des actions en milieu scolaire, qui a poussé le développement d’outils pédagogiques, d’actions, le renforcement de compétences des animateur·rices…
On aime bien le terme de « sensibilisation » parce qu’il y a une dimension sensible : on essaye de faire appel à la sensibilité du public auquel on est confronté. C’est pour ça que l’aspect culturel peut entrer en jeu, le témoignage et l’illustration concrète sur les panneaux sont aussi des choses qui parlent.
Et vous parlez « d’enfants étranger·es », et pas de « migrant·es » ou « réfugié·es » ?
C’est une grande question. On se partage souvent entre « exilé·e » ou « migrant·e » ou « étranger·e ». Mais pour « migrant·e », on a l’impression que cette personne est en perpétuel déplacement, que ça ne parle jamais de la fin du voyage, de l’installation de la personne. On préfère donc dire « étranger·e », on a l’impression que ça véhicule moins cette image de quelqu’un·e qui ne va jamais s’arrêter. Et puis aussi parce que ce terme « d’enfant étranger·e » insiste plus sur la nationalité, qui est un déterminant important. Peut-être aussi parce que notre approche s’intéresse aux droits : tu as la nationalité française ou tu ne l’as pas.

Un des outils pédagogiques de La Cimade les plus connus, c’est « le parcours de migrant·e·s ». Pourriez-vous nous expliquer quel était son objectif pédagogique ?
C’est un outil qui date de 2006-2008, avec plein de réactualisations. La dernière date de 2018. Il fonctionne comme un jeu de l’oie. Avec des personnages, qui ont des papiers ou qui n’en ont pas. Certain·es ont un visa. D’autres des parcours migratoires très compliqués. Avec des embûches, un recours aux passeurs. Le jeu, c‘est d’arriver à la case « arrivée » en ayant des papiers parce que les papiers sécurisent et permettent d’aller vers une vie décente et normale.
Mais comme il y a des lois sur les migrations à peu près tous les deux ans, c’est un jeu qui nécessite d’être mis à jour régulièrement, si on veut être correct sur les parcours.
C’est un jeu qui peut être utilisé avec différents publics, mais pas avant la 4e.
Il fonctionne à partir de questions/réponses, qu’on peut sélectionner selon son public.
Pour celles et ceux qui découvrent la situation des personnes étrangères, quand on finit une partie, l’impression, c’est qu’il y a vraiment plein d’embûches posées par l’administration française pour couper l’envie aux gens de s’installer. C’est un peu ce sentiment qu’on cherche à susciter en mettant dans la peau de gens qui, pour certaine·es veulent étudier, d’autres retrouver leur famille.
Est-ce qu’il est nécessaire d’y être formé·e pour pouvoir l’animer ?
Non, mais c’est souvent une remarque qui nous est faite en formation de bénévoles. Par contre, les règles sont un peu compliquées, il faut donc au moins y jouer plusieurs fois avant de l’animer. Mais il n’y a pas besoin de connaissances juridiques spécifiques.
En tous les cas, dans les retours des gens auprès de qui on l’anime, personne n’a jamais essayé de piéger qui que ce soit sur quels papiers il faut. Peut-être il faut au moins une « culture G » sur le vocabulaire (OQTF…). On a quand même ajouté un lexique dans la règle du jeu.
Vous l’avez animé aussi auprès des bénévoles des permanences juridiques ?
Pour celles et ceux qui sont bénévoles à la fois en sensibilisation et permanence juridique, c’est beaucoup plus facile de l’animer. Un·e bénévole juridique peut se casser les dents à l’animer tellement il·elle peut se positionner comme expert·e. Ce qu’on conseille aux nouveaux·elles bénévoles (on l’anime toujours lors de l’accueil des nouveaux·elles bénévoles) , c’est de l’animer en binôme : un·e bénévole pour la sensibilisation, un·e bénévole pour le juridique.
Est-ce qu’il y a d’autres dimensions dans le jeu que la nationalité ? Est-ce que vous montrez aussi les inégalités, par exemple, de genre ?
On a des apports pour chaque personnage, sur certains aspects, dans les fiches parcours. Selon le temps dont dispose l’animateur·rice, il est possible de les donner ou pas. Selon le « niveau » des participant·es, aussi.
Chaque personnage reçoit des « atouts » : argent, travail, logement, langue, etc. On a voulu mettre ces « atouts » pour montrer que les personnes étrangères ont des richesses (au sens large : compétences…). Il peut t’arriver des galères, par exemple de logement, mais si tu possèdes un atout, tu t’en sors. Si tu ne l’as pas, tu restes dans la galère et tu recules d’une case. On a aussi essayé de refléter les questions de classe sociale, avec les questions d’argent.
On a aussi un personnage homosexuel qui est obligé de quitter son pays.
Et puis, il y a les démarches des personnages : certains demanderont l’asile, d’autres pas. Les démarches ne seront pas les mêmes.
Nous avons proposé 10 personnages dans ce jeu, il est donc possible d’arriver à montrer les inégalités de parcours. Par exemple, un·e mineur·e afghan·e, quelle que soit la manière d’animer, il·elle avancera toujours très lentement. Et puis, on a des personnages qui sont déjà arrivé·es en France et on s’intéresse à ce qui leur arrive à la « fin » de leur parcours. C’est bien montré dans la mécanique du jeu, ils·elles ne partent pas tou·tes des mêmes cases. Certains personnages partent de trois cases plus loin et doivent rattraper leur retard, et peuvent ne pas y arriver. Alors qu’un personnage, étudiante brésilienne, arrive beaucoup plus vite.
Comment avez-vous pensé la fin du jeu ?
Il faut au moins 1h30 – 2h pour y jouer. On a prévu plusieurs façons de terminer le jeu (on l’indique toujours en début de jeu) : soit quand le·la 1er·e joueur·se est arrivé·e, soit au bout d’1h30, celui·celle qui gagne est celui·celle qui est allé·e le·la plus loin.
Ça dépend aussi beaucoup des animateur·rices. Il y a des cartes avec des niveaux de difficulté différents. Avec les plus jeunes, il vaut mieux choisir les plus simples.
Sur le plateau, il existe une case « chance » qui permettra de trouver une issue positive. Ca sera le dé qui va le décider. On trouve que c’est important aussi de montrer que dans la vraie vie, en fonction de la préfecture dont tu dépends, d’où tu habites, tu n’auras pas les mêmes retours à tes demandes de papier. Il y a aussi ce côté hyper hasardeux qu’on voulait retranscrire dans le jeu.
Il y a des éléments vraiment durs dans l’expo et dans le jeu. Est-ce qu’en fin de séance de sensibilisation, vous faites un retour sur le ressenti des joueur·ses ?
Oui, on le conseille. Si il y a plusieurs joueur·ses, on essaye de bien mélanger des parcours plus faciles, plus longs, compliqués…
Mais du fait de ces éléments difficiles, avec les jeunes, on sèche toujours un peu avec le côté « passage à l’action ».
Parmi les autres outils pédagogiques de La Cimade, vous avez créé un quiz pour la journée internationale de l’éducation. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s’agit ?
Nos quiz existent depuis environ un an. Avant, ils étaient en format papier. C’était pour répondre à la demande des bénévoles qui voulaient aller faire des actions d’interpellation dans l’espace public, dans les marchés…
Avec le confinement, on s’est dit qu’il faudrait s’adapter au contexte. Et qu’on les diffuserait sur les réseaux sociaux. On en a 7-8, en lien avec les journées mondiales (femmes, éducation). Pour le 8 mars, on avait fait un quizz sur les femmes migrantes qu’on oublie souvent alors qu’elles représentent plus de 50 % des migrations.
En 2019, La Cimade a lancé une campagne, « Quand Tout Bascule », co-écrite avec des personnes étrangères : pourquoi, à cette date, vous avez eu besoin de changer de pratique et de les associer ? Comment s’est passé le processus ?
Cela faisait quelques années qu’on voulait dépasser la posture d’aidant·es de personnes étrangères, pour passer au « faire avec ». Ne plus être dans le « caritatif ». Dans les permanences, il y a toujours un décalage entre le·la bénévole expert·e et la personne en demande, qui est perdue. Il peut y avoir un peu un rapport de domination. Il faut être vigilant·e au niveau déontologique. Il y a plein de personnes étrangères qui sont devenues de fait des expertes juridiques, du fait des démarches hyper compliquées qu’elles ont du faire. On avait fait le même constat sur les campagnes de com’, on trouvait qu’elles pouvaient entretenir des préjugés, et qu’il fallait donc y associer les 1er·es concerné·es.
On a eu une phase de repérage de personnes, en consultant nos bénévoles. Des personnes qui ont été accompagnées il y a plusieurs années, qui sont dans une situation un peu plus sécurisée. C’est compliqué pour les personnes précaires de se mobiliser dans une campagne de communication.
Pendant un an, le groupe de travail s’est réuni sur des journées entières. On a été accompagné par une SCOP d’éducation populaire. On avait besoin de cet accompagnement, parce qu’au sein de ce groupe mixte, il fallait pouvoir prendre conscience qu’on n’était pas à égalité : dans qui on est, dans la prise de parole en public, dans l’habitude de ce genre de méthode de travail… Ça a pris du temps. Mais ça valait vraiment le coup. Le processus était presque plus intéressant que le résultat.
Au final, on a eu 4 films de témoignages de personnes du groupe. Et un slogan « quand tout bascule » qui est venu aussi des réflexions avec elles et eux.
Ça a aussi pris pas mal de temps parce qu’il y a eu toute une phase de construction de confiance entre toutes les personnes du groupe et pour arriver à remettre de l’égalité. Par exemple, je pense à une jeune fille dont le témoignage est illustré. Elle avait une vingtaine d’années, était très timide, ne prenait pas la parole. On l’a vue, au fur et à mesure des séances, prendre de l’assurance, dire qu’elle n’était pas d’accord… Si on n’avait pas pris autant de temps, on n’aurait jamais réussi à avoir son témoignage vidéo.
En formation ou animation sur les questions des migrations, on se pose souvent justement la question de faire venir témoigner les 1er·es concerné·es. Qu’en pensez-vous ? Est-ce qu’il n’y a pas un risque de « voyeurisme » ?
Si à La Cimade on essaye d’encourager les témoignages, il faut garder une posture éthique. Il faut, toujours, bien sûr, leur demander leur accord : s’ils·elles sont d’accord, sur quoi ils·elles veulent témoigner. Ils·elles n’ont pas forcément envie de tout raconter. Il y a toute une phase assez longue qui doit être pensée. Le risque de tomber dans un truc « sensationnaliste » est grand. La question de la déontologie est essentielle. Dans les permanences, le rapport de dépendance entre l’accompagnant·e et l’accompagné·e est grand. Parfois des bénévoles en sensibilisation se font accompagner d’une personne étrangère pour qu’ils·elles témoignent. Mais c’est rare.
Quelles sont les urgences/thématiques importantes aujourd’hui si on veut sensibiliser aux droits des migrant·es et personnes étrangères ? Le Covid19 ? L’enfermement en CRA (centre de rétention administrative) ?
Ces deux questions sont importantes.
Il y a aussi la question de la suspicion généralisée des personnes étrangères, toutes les mesures mises en place (assignation à résidence, expulsion…). La question des amalgames (« c’est des fraudeur·ses, des terroristes »). Toutes les questions de préjugés et stéréotypes.
Et puis aussi la question des sans-papier·es qui font tourner la France mais qui ne sont pas régularisé·es.
Notre prochain petit guide sera sur « vivre quand on est sans-papier en France ». On est au début de la réflexion. On voudrait montrer comment la question des papiers entrave toute ta vie quotidienne : travailler, étudier, avoir une famille… On espère une parution pour la fin de l’année 2021.
Merci.
