Depuis environ cinq ans, le terme « décolonialisme » a émergé dans le débat public français, dans les discours politique, journaliste et intellectuel. Accompagné de tout un ensemble de mots relevant de la même constellation négative considérée par ses adversaires comme un danger idéologique pour la France et pour la République – wokisme, indigénisme, écriture inclusive, islamo-gauchisme, intersectionnalité, néo-féminisme, racialisme, communautarisme –, il est devenu l’un des emblèmes des menaces visant l’identité nationale (en favorisant la repentance) et l’éventuelle dissolution de l’unité française (en mettant l’accent sur les différences de genre, de classe, de religion, de race, d’ethnicité, etc.).
Le terme semble aisé à comprendre dans la bouche de ses adversaires. Ainsi, l’Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, créé en 2021 par un appel de 76 universitaires, invite à se dresser contre « un mouvement militant » qui, dans l’enseignement supérieur et la recherche, entendrait « imposer une critique radicale des sociétés démocratiques, au nom d’un prétendu “décolonialisme” et d’une “intersectionnalité” qui croit combattre les inégalités en assignant chaque personne à des identités de “race” et de religion, de sexe et de “genre” ». Sur le site de l’Observatoire, la « définition » du « décolonialisme » est simple, mais il importe de la citer assez longuement :
Le décolonialisme part d’un aphorisme simple : toute affirmation « tu es » procède d’une grille de lecture culturelle liée à un « Je » qui reflète en miroir l’opinion mainstream de cette culture. Soit le « Je » y adhère, soit au contraire il s’y soumet. Ce mécanisme est un « colonialisme » de l’esprit reposant sur un aphorisme simple :
Coloniser c’est mal.
Or éduquer : c’est coloniser les esprits.
Donc éduquer c’est mal.Ce colonialisme existe à tous les niveaux d’une société : au niveau micro-local où les rapports de force sont soutenus par une vision condescendante du colon pour le colonisé ; au niveau démocratique où le colon impose sa grille politique ; au niveau scolaire, où le colon impose sa vision de l’histoire ; au niveau mondial, où le colon impose sa vision de l’économie.
Le colon, en l’espèce, est porteur des germes d’une culture dominante à tous les niveaux : il est occidental et donc soumis à l’Empire américain, il est capitaliste, il est hétérosexuel : en un mot – il est blanc. [1]
On le voit, il ne s’agit finalement pas d’une définition. Ce qui est ici en jeu est la formation d’un néologisme – « décolonialisme » – à partir de l’affirmation selon laquelle il existerait un ensemble idéologique organisé autour de la dénonciation d’une omniprésence du colonialisme à tous les niveaux de la société. Cette mise en mot est problématique car, en dépit de la référence ci-dessus à l’Empire américain, les détracteurs du décolonialisme lient son émergence aux campus états-uniens et aux conséquences de l’appropriation, aux États-Unis, des écrits des philosophes français Michel Foucault, Jacques Derrida ou Gilles Deleuze. [2] En ce sens, il serait une « maladie étrangère », un virus qui menacerait non seulement l’intégrité de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais tout simplement l’unité de la République française.
Il existe pourtant une tout autre généalogie permettant de saisir tout autrement ce qu’est la colonialité et le décolonial. Elle s’inscrit au sein d’un collectif d’auteur·rices latino-américain·es qui commencent à se réunir à partir de la première moitié des années 1990. Elle s’articule notamment autour de deux figures : celles du sociologue péruvien Aníbal Quijano et du philosophe argentino-mexicain Enrique Dussel. Le premier a forgé en 1992 la notion de « colonialité du pouvoir » pour désigner la face cachée de la modernité qui se met en place à partir du xvie siècle. [3] Les conséquences de la colonisation de l’Amérique latine par les Européens se manifestent par la création et la persistance, malgré la décolonisation, d’une matrice hiérarchique raciale, sexuelle, économique et épistémique, par laquelle se manifeste continûment la distinction entre les Occidentaux et les non-Occidentaux. Dussel, quant à lui, insiste sur l’importance de voir la modernité naître après 1492, qui n’est pas le moment de la « rencontre » entre les peuples mais celui de « l’occultation de l’autre ». [4] Tout en critiquant le poids constant des structures de la colonisation, il en appelle à la venue d’un moment nouveau, la transmodernité, [5] où l’universalisme comme discours occidental céderait le pas à un pluriversalisme ouvert au dialogue interculturel. [6]

Postcolonial et décolonial
De la même façon qu’il ne faut pas confondre colonialisme et colonialité, la fin du premier (l’accès à l’indépendance politique) n’impliquant nullement la fin de la seconde, il ne faut pas non plus assimiler pensée postcoloniale et pensée décoloniale. En effet, cette dernière est largement née d’une rupture avec la première. Cette rupture se fonde sur l’opportunité ou non de continuer à s’appuyer sur des auteurs occidentaux comme Foucault, Derrida ou Gramsci pour développer une pensée autonome. C’est ce qu’ont largement fait des auteurs dits postcoloniaux comme Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak ou encore Ranajit Guha, le fondateur des Subaltern Studies indiennes. Dans le cas de l’Amérique latine, au cours des années 1990, une partie de la lutte pour la décolonisation du savoir passe par la recherche d’une plus grande authenticité des concepts et des références, comme le montre notamment la création en 2000 de la revue Nepantla [7], qui matérialise la constitution d’une nouvelle option épistémique, celle du décolonial par rapport au postcolonial. Pour reprendre les termes de Ramón Grosfoguel, la rupture s’accomplit ainsi entre celles et ceux qui voyaient la subalternité à partir d’une critique postmoderne (c’est-à-dire une critique eurocentrique de l’eurocentrisme) et celles et ceux qui la lisaient à partir d’une critique décoloniale (à savoir une critique de l’eurocentrisme à partir des savoirs subalternisés et réduits au silence). [8]
La décolonialité consiste alors en un double mouvement : elle vise à réduire la portée universelle des théories et des concepts occidentaux en les renvoyant aux conditions historiques et géographiques de leur production, ainsi qu’à favoriser les réémergences et les résurgences des formes de savoir ayant été historiquement désavoués. [9] Dans ce cadre, aller vers la décolonialité ne signifie pas aller vers une simple décolonisation, car la colonialité engage non seulement une vision plus large que celle du colonialisme, mais elle n’implique pas non plus les mêmes réponses. Dans la perspective décoloniale, l’accent est mis sur la capacité des populations culturellement ou scientifiquement dominées à se défaire de l’emprise occidentale avant tout afin de pouvoir imaginer de nouvelles formes culturelles et de nouveaux lexiques conceptuels, ou bien de « retrouver » des formes anciennes. L’idée de « déconnexion », proposée par Samir Amin dans un ouvrage éponyme de 1986, [10] mais aussi celles de « desprendimiento » de Quijano, [11] de « delinking », de « détachement » ou de « désobéissance épistémique » que l’on trouve plutôt chez le sémiologue argentin Walter Mignolo, visent plus largement à rendre possible un changement de fondation afin de souligner l’existence autonome d’autres formes de savoir. Au lieu de s’appuyer sur les perspectives d’un universalisme à l’occidentale unique ou bien d’une hybridation générale des différents savoirs locaux, l’approche décoloniale invite à inclure les différences au sein d’une autre vision de l’universel. Selon les termes de Walter Mignolo, « la notion de détachement oriente le tournant épistémique décolonial vers une universalité-autre, c’est-à-dire vers la pluriversalité comme projet universel. » [12] La difficulté de cette vision est la conciliation – apparemment paradoxale – entre l’universel et le pluriversel, le second étant la condition du premier. Pour cela, l’accent est mis sur la reconquête de formes de savoir antérieures qu’il s’agit alors de « reconstituer » comme de vraies formes de savoir :
Alors que l’objectif de décolonisation se signalait par la lutte de la population native ou autochtone afin d’expulser les colons des colonies et de former leurs propres État-nations sur les ruines des anciennes colonies, la décolonialité ne vise plus à la décolonisation. Son but et son orientation, si l’on suit le virage proposé par Quijano, sont la reconstitution épistémique. Il est impossible de l’atteindre par l’établissement d’une « nouvelle » école de pensée au sein de la cosmologie occidentale. [13]
Envisagé sous cet angle, le passage à la décolonialité implique une redéfinition des valeurs relatives du local et du global. Il s’oriente non plus vers la recherche de l’universel promu par les grands récits occidentaux mais vers la promotion du « pluriversel » :
Les reconstitutions épistémiques décoloniales (…) ne peuvent être considérées comme de l’universel global mais comme du pluriversel global. Aucune décolonialité universelle ne peut être cartographiée au moyen d’une histoire locale unique et d’un projet unique. Telle était justement l’aberration des projets globaux modernes (modern global designs). Telle est justement l’aberration de la modernité occidentale, de l’occidentalisation et de la ré-occidentalisation. [14]
Cette pensée complexe, dont il nous est seulement possible ici de donner un aperçu bien trop court, et qu’il faudrait par exemple approfondir par la mention des travaux de l’anthropologue américano-colombien Arturo Escobar, [15] exerce aujourd’hui une profonde influence à l’échelle mondiale. Ses hypothèses, ses concepts, nombre de ses auteur·rices (Quijano, Dussel, Mignolo, Escobar, etc.) sont cité·es dans le monde entier. Pourtant, le cas de la France montre que cette réception de la pensée décoloniale peut être compliquée par des facteurs intellectuels et politiques.
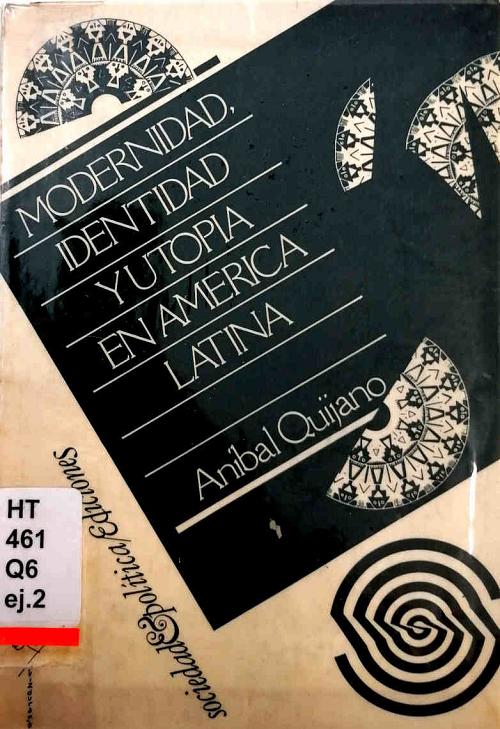
Le cadre ancien du discours néo-républicain
Comment peut-on expliquer que des termes académiques comme « postcolonial » ou « décolonial » – en particulier sous la forme hyper-politisée et donc scientifiquement disqualifiée de « décolonialisme » – soient ainsi devenus en France des mots d’accusation, de véritables anathèmes contre celles et ceux qui les utilisent ?
L’une des raisons tient évidemment aux moments où ils acquièrent une plus grande visibilité dans les débats intellectuels, médiatiques et politiques. Portés par certains groupes militants comme par exemple, en 2005, le Manifeste des Indigènes de la République (devenu depuis le Parti des Indigènes de la République) mais aussi – en ce qui concerne le terme « décolonial » – depuis le milieu des années 2010 par différents mouvements sociaux se réclamant de la lutte contre les discriminations, ils sont devenus la cible d’intellectuels et de membres du personnel politique qui y voient le risque d’une histoire de France portée par la culpabilité de l’esclavage, de la colonisation et de la gestion de l’immigration, ainsi qu’une atteinte à la dimension unitaire du peuple qui disparaîtrait au profit d’identités de race, de genre, d’ethnie, de religion, etc.
Cette vision particulière trouve également une place spécifique à l’intérieur d’une histoire plus longue, celle d’une néo-républicanisation progressivement installée depuis un peu plus de trente ans. L’année 1989 est sans doute l’un des premiers temps forts de la formation de ce discours néo-républicain largement organisé autour de l’idée d’« exception française », d’abord avec la critique intellectuelle des cérémonies du Bicentenaire de la Révolution, jugées trop multiculturalistes, puis avec les débuts de l’« affaire du voile », à partir du mois de septembre. Les années 1990 voient ainsi l’instauration d’un large consensus politique autour de plusieurs notions : l’exception républicaine française, l’universalisme des valeurs républicaines et l’indivisibilité du peuple français. Elles sont mobilisées pour dire l’impossibilité et le danger de dépasser la France par le haut ou par le bas, par des processus supranationaux, comme l’européanisation ou la mondialisation économique voulue par le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), ou bien par des revendications de reconnaissance infranationale.
L’article 1 de la Constitution de 1958, qui précise que la France est une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale », sert de support à cette conception de l’exceptionnalité nationale. Par ailleurs, la critique des États-Unis est omniprésente au cours de cette période dans les discours politique et intellectuel, car elle offre la possibilité de défendre la vision d’une nation unie s’opposant en tout point à un pays gangrené par la violence, divisé entre communautés – raciales, ethniques, religieuses, sexuelles… – et principal exportateur de l’« idéologie » multiculturaliste. L’opposition fondamentale entre les deux modèles politiques ne concerne pas seulement les régimes en question, mais aussi le moteur de ces régimes. Dans le discours néo-républicain, l’universalisme français est l’antithèse du « communautarisme » américain.
Les décennies 2000 et 2010 sont sur la continuité de la précédente. Les discussions relatives à la laïcité (en 2004) ou sur la loi relative à la dissimulation du visage dans l’espace public (en 2010) poursuivent la même matrice discursive. Le « débat sur l’identité nationale » de 2009-2010 ou les polémiques contemporaines sur la « repentance » ou les déboulonnages de statues y contribuent en creux par la valorisation d’une « légende nationale » dont l’unité historique, culturelle et civilisationnelle ne saurait être mise en question.
En quoi cela touche-t-il la pratique des sciences humaines et sociales ? En fait, très directement. D’une part, depuis les années 2000, les travaux constructivistes en sciences sociales se retrouvent souvent accusés de ne pas « croire » à l’identité nationale, à son essence, et de faire ainsi le lit du pluralisme et de la diversité ! Par ailleurs, on ne peut que constater la transformation, au cours des vingt dernières années, d’une partie des objets de recherche. La multiplication de travaux liés au genre, à la race, à l’ethnicité, au religieux, aux identités et aux discriminations, autant de thématiques souvent portées par une nouvelle génération de chercheur·ses se sentant directement « concerné·es » par ces nouveaux objets, a contribué à « crisper » certain·es universitaires plus ancien·nes et à relativiser certaines perspectives explicatives, comme celles des classes sociales, au profit d’approches plus largement « identitaires » et constructivistes. Si les partisan·es d’une perspective universaliste prennent de plus en plus les sciences humaines et sociales pour cible, c’est parce qu’ils et elles estiment que, pas plus que la loi française attentive à défendre les « valeurs de la République », l’universalisme scientifique ne saurait tolérer les attaques académiques à l’indivisibilité qui, tout comme le multiculturalisme politique et sous la même forme que lui, proviennent d’outre-Atlantique et mettent en péril l’unité de la France.
Il semble pourtant bien que le péril le plus grand soit celui de la myopie et de l’insularité qui caractérisent nos visions des sciences sociales. Largement incapables de voir de loin et d’apprécier – sans nécessairement embrasser – les débats qui se déroulent autour de nous, nous continuons à nous enfoncer dans un récit passéiste et légendaire des sciences sociales alors que dans la plupart des grandes régions du monde (Amérique latine bien sûr, mais aussi dans le monde arabe, en Afrique subsaharienne, en Europe centrale et orientale, ou bien encore en Asie), les débats sur le futur des sciences sociales sont en train d’être menés depuis bien longtemps.
